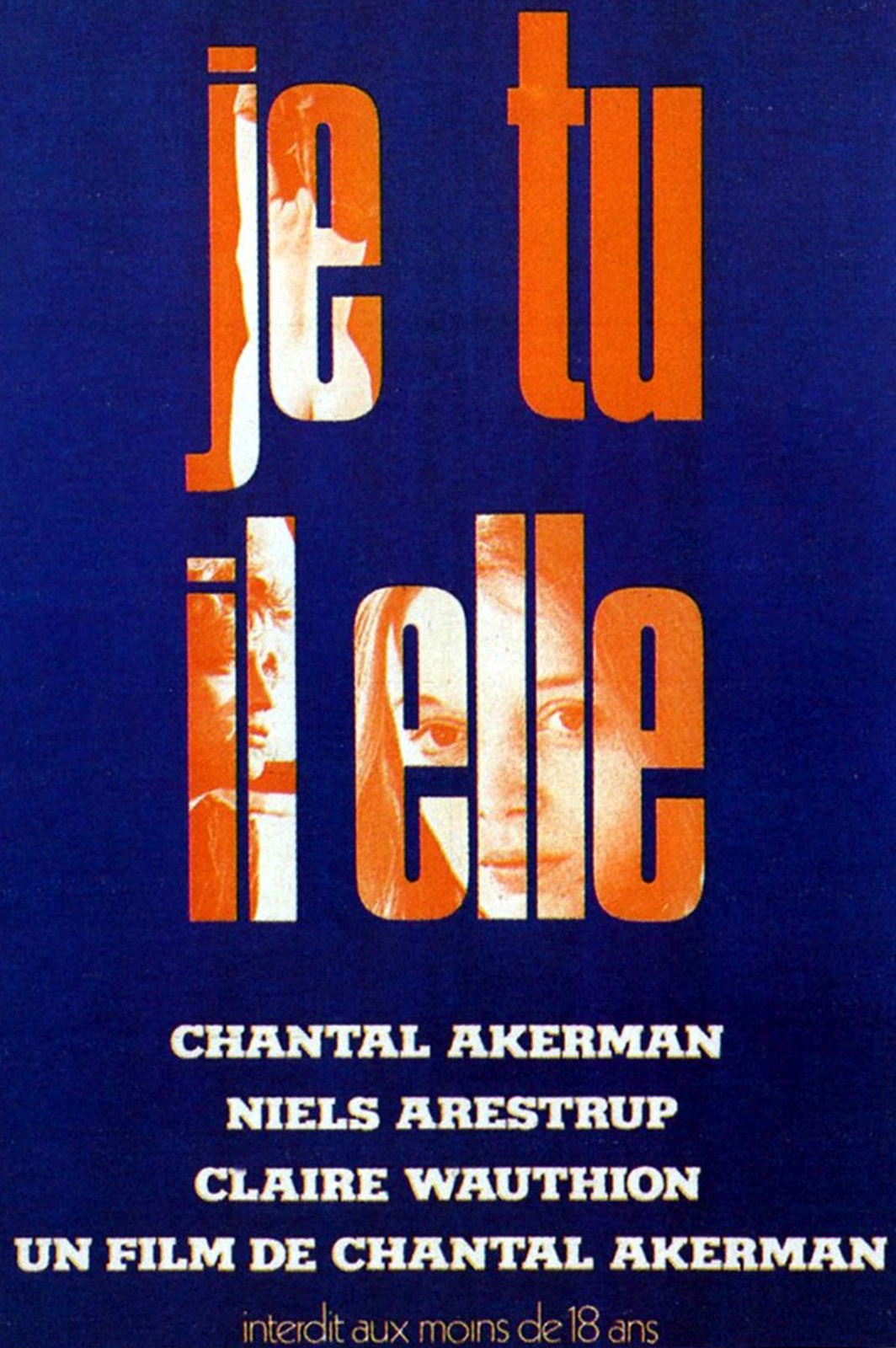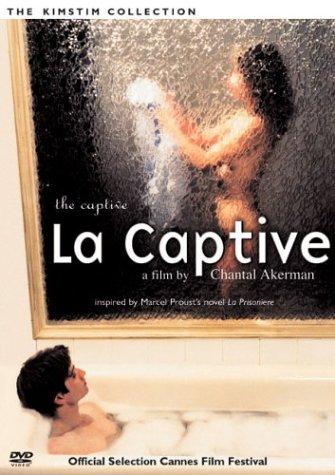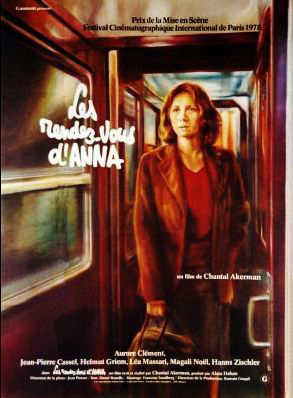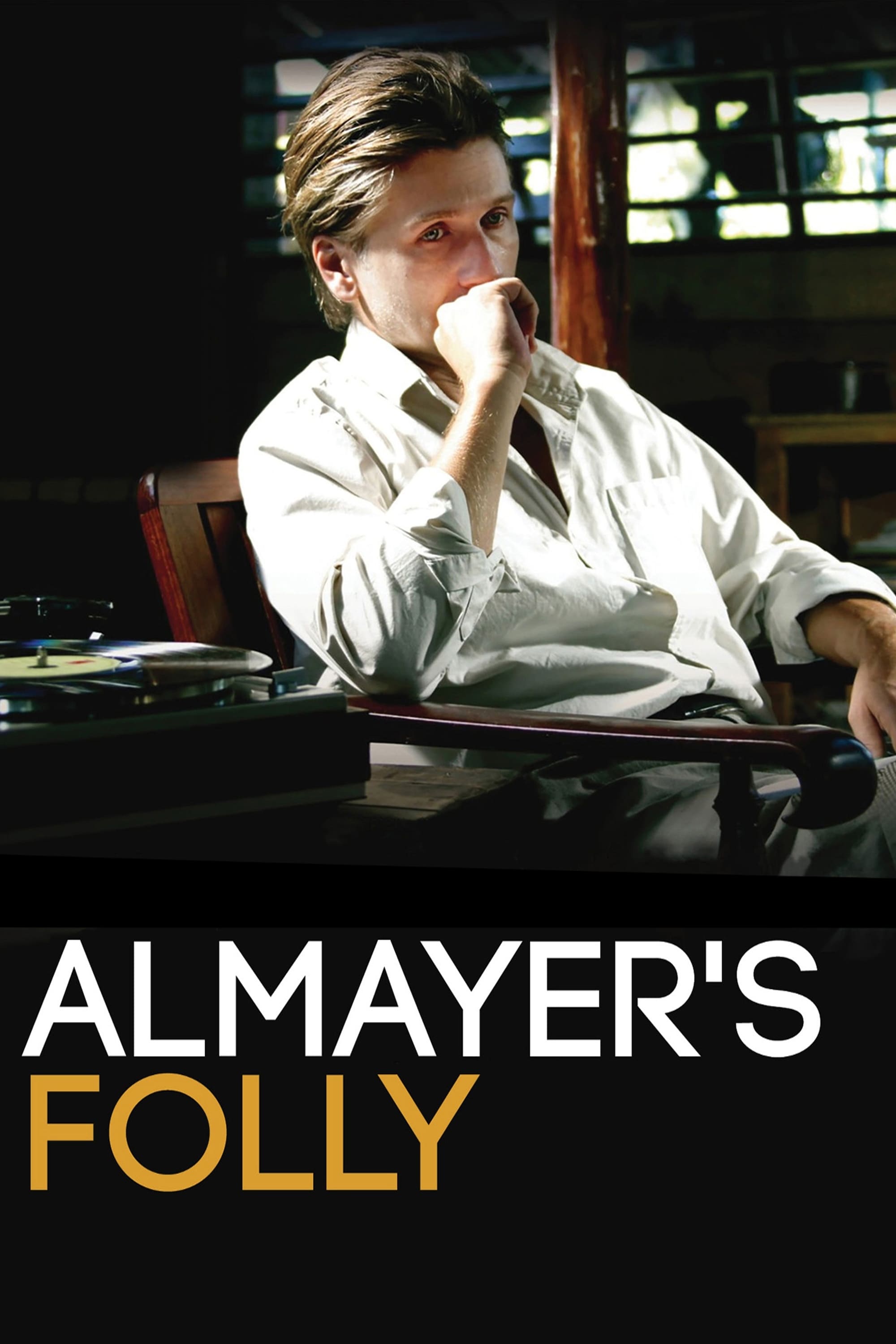De Chantal Ackerman. 1976.
Avec Delphine Seyrig.
3 jours de la vie d’une femme veuve, ménagère dont la vie tourne entièrement autour des tâches ménagères. Même avec son fils ado qu’elle retrouve le soir il n’y a pas vraiment de communication. 3h de film et d’immense solitude qui va se transformer en totale névrose jusqu’à l’acte final (elle tue un de ces hommes qu’elle reçoit l’après-midi contre de l’argent). Dans ce silence une intensité toute particulière des sons ambiants ( gaz,bouilloire, robinet d’eau, ascenseur…)Glaçant! Véritable performance inédite surtout pour une réalisatrice de 25 ans!
Telerama
Radical sur le fond comme sur la forme, Jeanne Dielman, 23, quai du Commerce, 1080 Bruxelles fait partie de ces œuvres inépuisables, sujettes à des interprétations multiples voire contraires. S’agit-il d’aliénation ou de griserie ? D’une érotique du travail domestique ? D’une ode à la frigidité ? Est-ce un manifeste féministe ou une satire burlesque ? Un film de Hitchcock au féminin ? En exagérant à peine, on serait prêt à soutenir chacune de ces hypothèses.
Une certitude, au moins : Chantal Akerman montrait en 1975, à travers ces plans fixes découpés au cordeau, ce qu’on n’avait jamais vu jusqu’alors. À savoir : l’activité sans temps mort d’une ménagère. Des tâches minutieuses que la réalisatrice jugeait aussi dignes d’être montrés qu’« un accident de voiture ou un baiser en gros plan ». Cette ménagère, c’est Jeanne Dielman, une femme toujours bien mise, d’une quarantaine d’années, qui vit seule avec son grand garçon. Ce couple étrange vit dans un petit appartement de Bruxelles, d’apparence bourgeoise. Sauf que le fils dort sur le canapé du salon et que l’argent manque — madame est veuve. Pour arrondir ses fins de mois, elle se prostitue. À domicile. Chaque après-midi, elle reçoit un client, dans sa chambre. Ce qui s’y déroule n’est pas montré.
Le reste, on le voit. C’est un emploi du temps très organisé, mais qui va se dérégler. Un récital d’actions domestiques, cadencé et sonore, comme un cœur qui bat. Un va-et-vient, un ballet de portes qui s’ouvrent et se ferment, une partie de cache-cache – Jeanne allume et éteint la lumière sans cesse. Et ce faisant, parle d’elle. Obsession du temps à occuper, d’un vide à remplir, frustration, satisfaction, contrôle, abandon de soi sont ici sublimés. Beauté blême et impériale de Delphine Seyrig, dame à la coiffure ondulée d’automne, qui brouille toute interprétation hâtive, transformant la routine en chorégraphie, en houle mélodieuse. Beauté de la composition géométrique des plans. Beauté encore du vert amande, du mauve, du rose pâle, de tous ces coloris exsangues, délavés.
Épuré, le film l’est jusque dans son salon miroitant où clignotent le soir d’étranges reflets bleus. La rumeur de la rue invite aussi à quelques sorties, où la ville revêt quelque chose d’irréel. Jeanne Dielman est à la fois le film suprême de la matière, des ustensiles de cuisine, des étoffes, des bibelots, des objets rangés, frottés, cognés, comme autant de preuves solides. Et celui du vague à l’âme, de l’eau, du sang, de la vie qui se liquéfie, se dissout. Voyez le finale, vanité languissante, tout y est.