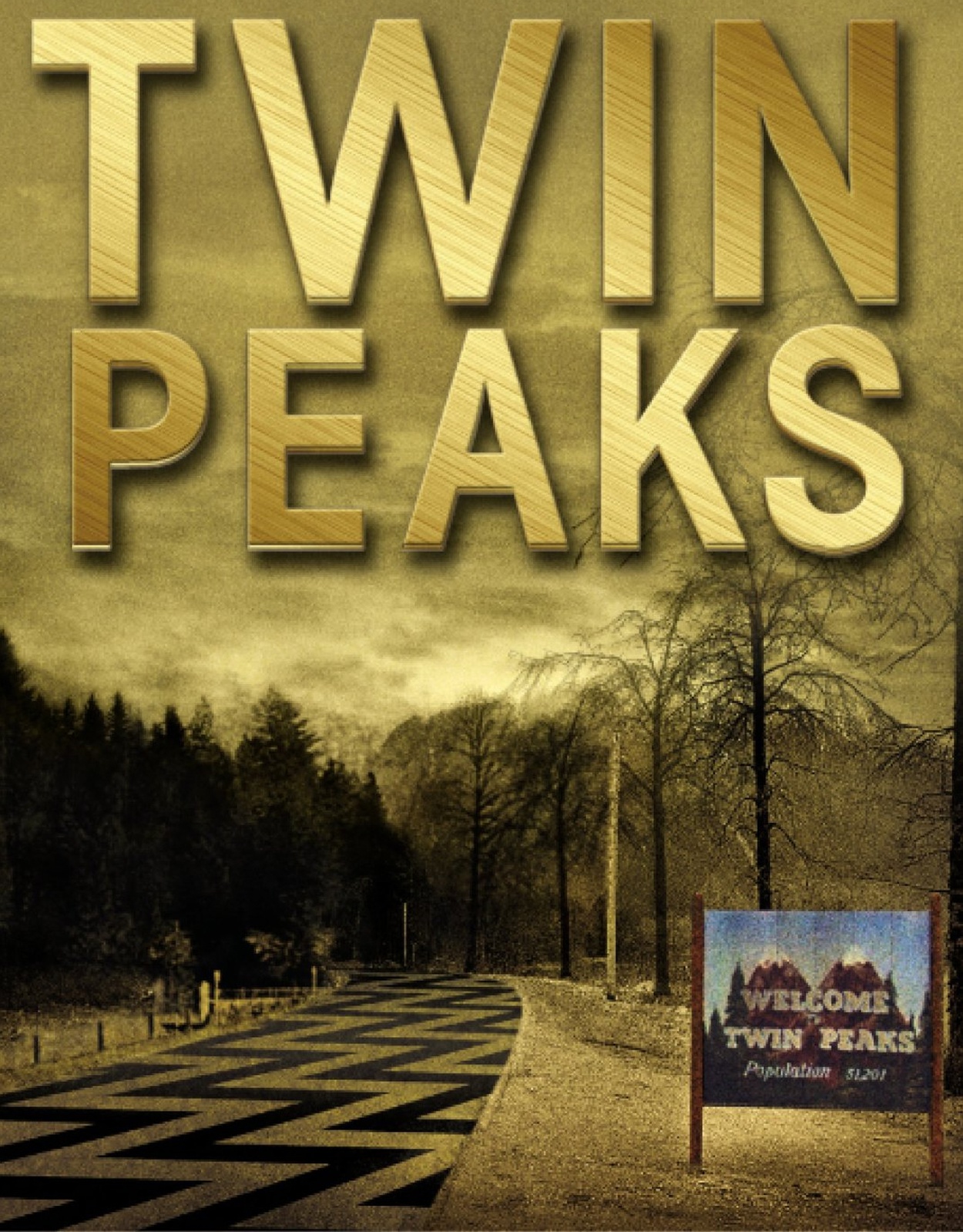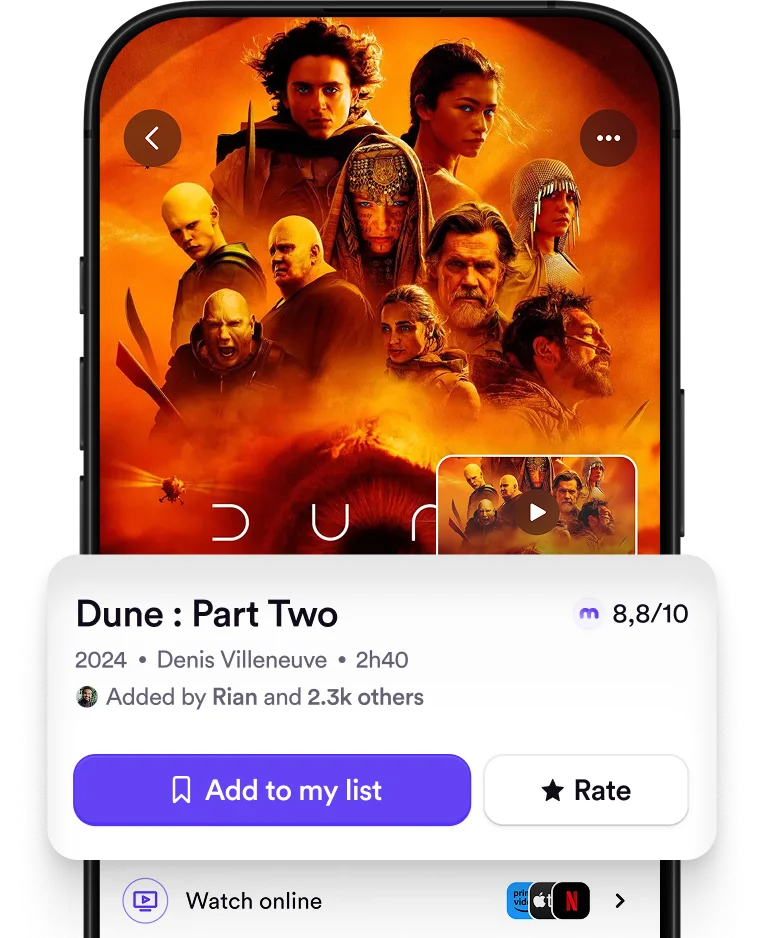https://www.dailymotion.com/video/x8u3tt8
Pourquoi “Twin Peaks”, de David Lynch, est la matrice de toutes les séries
En 1990, le réalisateur américain, mort ce jeudi 16 janvier à 78 ans, signait son chef-d’œuvre absolu : la série culte “Twin Peaks”, découverte en France sur La Cinq… Un objet inédit, à la fois hommage à un monde révolu et totalement novateur.
Par
Réservé aux abonnés
Publié le 17 janvier 2025 à 17h52
Le 8 avril 1990, a fait une bonne blague aux spectateurs de la chaîne américaine ABC. Ceux qui avaient consulté leur programme télé ce jour-là pensaient s’asseoir devant un polar classique. Une lycéenne nommée Laura Palmer est découverte sans vie au bord du lac d’une bourgade forestière, le visage violacé, « wrapped in plastic » (emballée dans du plastique). Un agent du FBI bien élevé vient mener l’enquête. Révolutionnaire, ça ? Pourtant, très vite, le public voit que quelque chose est différent. La mère de la défunte pleure trop fort, elle pousse même des cris déments sur le cercueil de sa fille. La courtoisie de Dale Cooper, ce détective amateur forcené de café et de tartes à la cerise, confine au burlesque.
À lire aussi
La musique est étrangement langoureuse. Et pourquoi ces gros plans insistants sur les objets inanimés qui peuplent la maison des Palmer ? Sous couvert d’une soirée comme les autres, le cinéaste, entre et , est en train de pirater en douceur l’esthétique télévisuelle. Avec la complicité du scénariste Mark Frost, il fait du whodunnit un voyage mental labyrinthique, horrifique et drolatique, qui envoûte aussi bien les cinéphiles que le grand public. Et en l’espace de deux saisons (complétées par une suite vingt-sept ans plus tard), devient la série de toutes les séries.
Le début de la télé postmoderne
Enfant des années 1950, ballotté de l’Idaho à l’État de Washington (où se déroule Twin Peaks), David Lynch est arrimé au téléviseur : son imaginaire se forme au contact des soap operas de l’époque, avec leur ambiance suburbaine et leur narration intarissable, qui requiert de flamboyants coups de théâtre, du mélodrame à gogo et parfois de faire revivre les morts. Twin Peaks, pour laquelle David Lynch et son cocréateur Mark Frost disent s’être inspirés de Peyton Place (1964-1969), est d’abord un pastiche amoureux de ces feuilletons à rallonge. Un hommage à la télévision d’un monde révolu, mâtiné d’une peur du noir et d’une fascination pour l’étrange, qu’on imagine conséquentes au visionnage précoce de La Quatrième Dimension.
À lire aussi :
Twin Peaks détourne les conventions du soap et les pousse jusqu’à l’horreur, jusqu’à l’absurde ou jusqu’au romantisme fou. Ces outrances en font un objet inédit, et la matrice d’une nouvelle écriture. Twin Peaks marque le début de la télé postmoderne : avec elle, on entre de plain-pied dans l’ère du méta, du mélange des genres et des séries à énigmes. Elle annonce également l’émergence des séries d’auteur. Lynch en signera coup sur coup deux autres, On the Air (1992) et Hotel Room (1993), mais sa manière de déconstruire les codes est devenue la norme en imprégnant celles des autres, de ou , dans les années 2000, jusqu’aux récentes The OA, Reservation Dogs ou La Mesías.
Une œuvre hybride
Venu du cinéma expérimental, Palme d’or à Cannes pour Sailor et Lula quelques semaines après le lancement de Twin Peaks, peintre à ses heures, Lynch est avant tout un créateur de formes, un esthète hanté de visions équivoques. Une anomalie au sein d’une industrie télé qui tend à privilégier la solidité du scénario. Avec Twin Peaks, le réalisateur adopte les tropes du médium télévisuel sans renoncer à la singularité de son regard. À la clé, une œuvre hybride, où l’intrigue policière est lardée de mouvements de caméra insolites, lents zooms, ralentis, plans récurrents sur un arbre qui bruisse ou sur un feu de signalisation la nuit…
À lire aussi :
L’inconscient cinématographique de Twin Peaks se trahit dans la figure de Laura Palmer, blonde iconique et suppliciée dont le visage bouffi par les eaux évoque celui de Marilyn sur son lit de mort (), et qui se dédouble en sosie aux cheveux noirs, comme dans . Ces signatures et résonances, étoffées par du compositeur attitré de Lynch, Angelo Badalamenti, donnent à la série une beauté sensorielle qui transforme le salon en salle obscure, et créent des instants qui échappent à l’efficacité narrative. Un peu trop au bout du compte : lestée d’inutiles digressions scénaristiques, la saison 2 perd ses spectateurs et signe l’arrêt de mort de la série. Lorsque Twin Peaks renaît en 2017 avec une miraculeuse troisième saison baptisée , le geste s’est radicalisé, tirant plus encore vers le formalisme. Entre-temps, Lynch aura ouvert la porte de la télévision aux réalisateurs de cinéma, qui, de Nicolas Winding Refn à Jane Campion, se bousculent aujourd’hui au portillon des séries.
L’héritage lynchien
Si déstabilisante soit-elle, Twin Peaks est un succès public, jusqu’en France où les spectateurs de La Cinq s’échangent leurs VHS en 1991. Culte, la série l’est dès son origine — on dit même que la reine d’Angleterre aurait interrompu une entrevue avec Paul McCartney par peur de manquer un épisode. Devenue un phénomène culturel, elle s’imprime sur des tee-shirts (« C’est moi qui ai tué Laura Palmer ») et fait l’objet de multiples clins d’œil dans d’autres séries, comme Les Simpson ou la comédie policière Psych (2006). Cet engouement s’ancre dans le fétichisme de la série : Bob, le terrifiant esprit qui visite Laura ; la red room, cet outre-monde bordé d’un rideau rouge où Dale va chercher la trépassée ; la tarte à la cerise, que les touristes vont déguster dans le diner de la vraie ville qui a servi de décor à Twin Peaks…
À lire aussi :
La cristallisation collective est alimentée par la fin, ouverte à l’interprétation. L’idée d’un mystère jamais résolu a contaminé notre rapport aux séries, qu’il produise de l’obsession voyeuriste (le genre true crime), des déductions et de la déception (Lost et ses questions sans réponses) et parfois un regard critique (Laura Palmer n’est-elle pas à l’origine de la vague de féminicides qui inondent les séries jusqu’à l’overdose ?). Quant à l’équation de départ — un macchabée vient révéler les secrets d’une petite communauté bien sous tous rapports —, elle est devenue celle d’un nombre incalculable de séries américaines (), scandinaves (The Killing) ou françaises ( ou Polar Park). Parfois jusqu’à l’épuisement — rien de pire qu’une lyncherie ratée. Mais à chaque fois que l’on croit l’héritage usé, une œuvre vient nous surprendre : dans le film I Saw the TV Glow, sorti l’année dernière aux États-Unis, des jeunes accros à une série télé zonent dans une banlieue résidentielle aux frontières du surnaturel. C’est Twin Peaks chez les milléniaux. Et la preuve que l’esprit de Lynch est bien vivant.