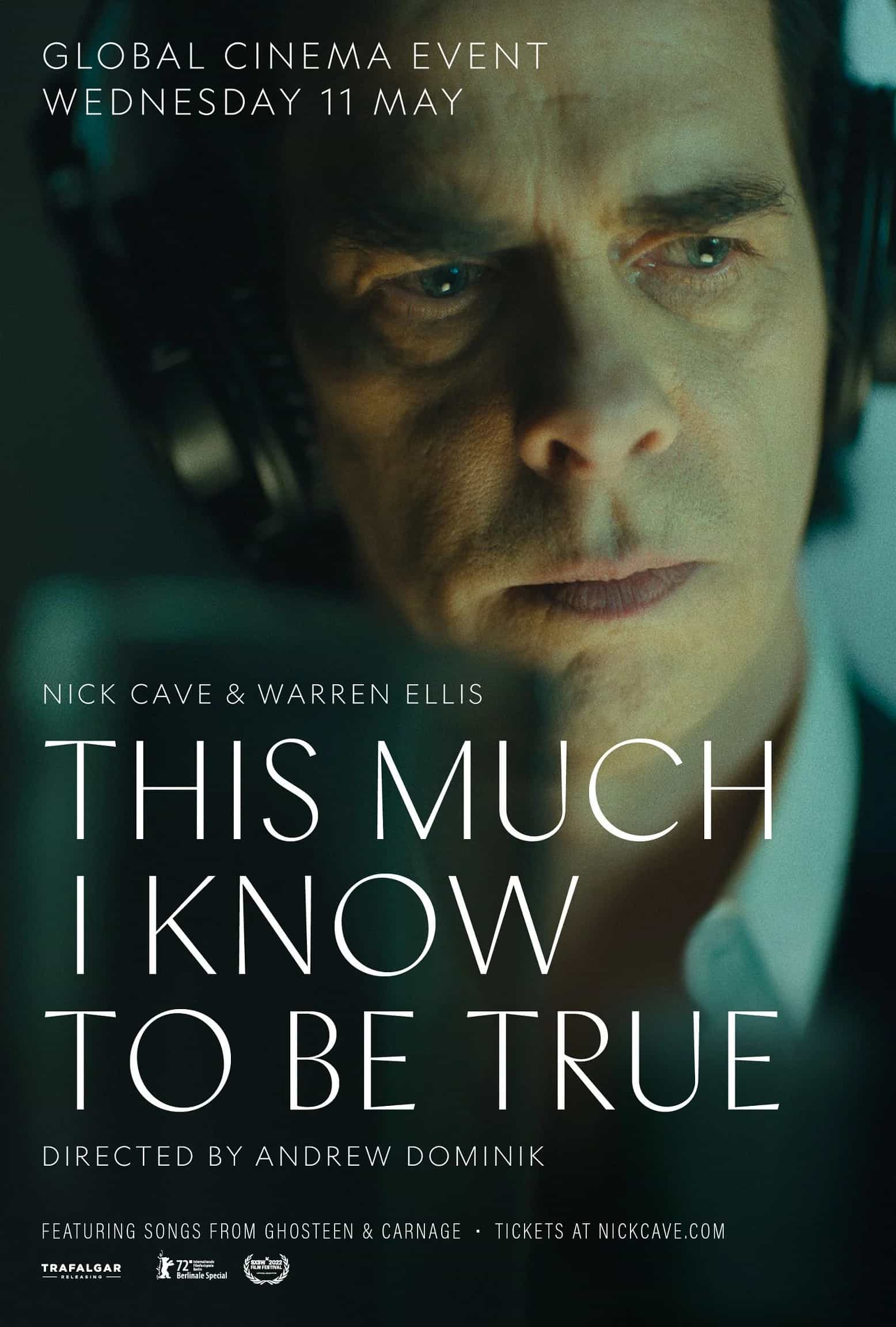Cogan : Killing Them Softly
De Andrew Dominik
2012
Policier / Thriller
1h37
Cogan : Killing Them Softly
De Andrew Dominik
2012
Policier / Thriller
1h37
6,2/10
3,3/5
Presse2,5/5
Spect.Synopsis
Lorsqu’une partie de poker illégale est braquée, c’est tout le monde des bas-fonds de la pègre qui est menacé. Les caïds de la Mafia font appel à Jackie Cogan pour trouver les coupables. Mais entre des commanditaires indécis, des escrocs à la petite semaine, des assassins fatigués et ceux qui ont fomenté le coup, Cogan va avoir du mal à garder le contrôle d’une situation qui dégénère…