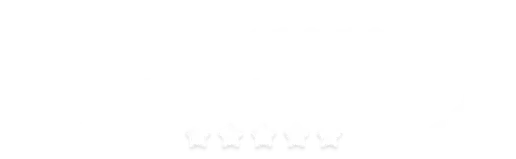Film de Robert Wise · 1 h 32 min · 18 septembre 1952 (France)
Genres : Science-fiction, Drame
Groupe : Le Jour où la Terre s'arrêta
Pays d'origine : États-Unis
Bande originale : The Day the Earth Stood Still, The Day the Earth Stood Still
Fiche technique
Venant d'une autre galaxie, Klaatu et Gort, son robot, atterrissent sur terre dans le but d'y établir une paix durable entre les hommes. Malgré la forme humaine de Klaatu, l'accueil qui lui est réservé est des plus hostile . Hospitalisé, il parvient cependant à s'échapper et rencontre une jeune femme qui devient son alliée.
Tourné en pleine guerre froide, le Jour où la Terre s'arrêta n'est pas un simple film de SF de série, mais une habile parabole sur la paix et le danger de la prolifération des armes nucléaires. La peur de l'atome et la peur de l'ennemi rouge sont les grands thèmes qu'on retrouve dans le cinéma de science-fiction hollywoodien des années 50, et là on est plein dedans.
L'arrivée sur Terre de Klaatu, étrange envoyé d'ailleurs à l'apparence humaine et parlant un anglais oxfordien (et premier extraterrestre non belliqueux), est un grand moment ; venu avertir les Terriens que leurs armes mettent en péril la paix et la sécurité du cosmos, il leur lance un ultimatum qui en gros dit ceci : Hé les gars, vous bousillez votre planète en menaçant la sécurité dans la galaxie, arrêtez ça ou on pulvérise la Terre façon puzzle ! Michael Rennie, excellent acteur de second plan (et qu'on retrouvera aussi en alien plus humain dans 2 épisodes de la série les Envahisseurs en 1967), trouve là son rôle le plus célèbre, de même que sa fameuse formule "Klaatu barada nikto" qui empêche le robot Gort de pulvériser la ville avec son rayon désintégrateur, a fait le tour de la planète. Cette scène d'arrivée symbolise la préfiguration de l'attitude des Etats-Unis face à d'éventuels agresseurs.
Le film ne tombe pas dans le piège du sujet à thèse et reste avant tout un divertissement malgré l'importance du problème (la paix et le désarmement), mais le plus intéressant réside dans les éléments de science-fiction mêlés à une très intelligente description du mode de vie quotidien des Américains tel que le découvre Klaatu. Je ne met pas la note suprême car il y a une petite baisse de rythme au milieu, mais j'aime beaucoup le ciné de SF hollywoodien de cette époque, comme dans Planète interdite, le Météore de la nuit ou la Guerre des mondes... En tout cas, ce film reste comme le film de SF le plus adulte des années 50, à une époque où le genre était traité de façon peu sérieuse, et bien plus réussi que son fade remake de 2008.
La fable pacifiste de Robert Wise.
Étrange personnage que ce Klaatu, extraterrestre qui débarque en plein cœur de Washington. À l’instar de l’armée et de badauds qui se massent autour de la soucoupe, c’est incrédule que nous voyons apparaître cet être anthropomorphe. Vêtu d’une combinaison à paillettes et accompagné de Gort, un robot serviteur – tout aussi kitsch -, le curieux parle notre langue et dit venir pour apporter la paix. Dans cette scène inaugurale, la simplicité des costumes n’a d’égal que le caractère rudimentaire des effets spéciaux. Lorsqu’un soldat ouvre le feu sur l’arrivant, Gort produit de simples halos de lumières, capables d’anéantir fusils et tanks, donnant là une idée de l’avancée technologique de leur planète sur la nôtre. Pourtant cette puissance de feu ne sera que suggérée durant une grande partie du film. Ces extraterrestres viennent pour nous délivrer un message, l’heure est donc à la discussion.
Film de science fiction-sorti en 1951, Le Jour où la Terre s’arrêta est bien un OVNI dans la production cinématographique de son époque. Alors qu’en pleine « Peur rouge » de nombreux films mettent en scène le danger que représente l’Autre (La Guerre des mondes de Byron Haskin en 1953, ou encore L’Invasion des profanateurs de sépultures de Don Siegel en 1956), Wise propose une démarche inverse. Le danger y est l’Homme tandis que son voisin de l’espace est pacifique et vient pour le raisonner. Klaatu arrive dans un contexte de Guerre froide, et son message est clair : mettre en garde la Terre face à l’usage du nucléaire. Si la Terre développe l’arme atomique, elle menace l’équilibre de l’univers et les planètes voisines n’hésiteront pas un instant à la supprimer. Quel que soit l’intelligence du propos, c’est bien la façon dont Wise nous le présente qui fait la réussite du film. Rapidement, Klaatu échappe aux autorités et abandonne son nom pour celui de Carpenter, devenant un Homme parmi tant d’autres. Wise ne filme plus l’extraterrestre mais l’homme incompris, perdu au milieu de ceux qui, en apparence, sont ses semblables. Son seul réconfort, il le trouve dans son rapport avec certains être humains : en premier Bobby, fils de la famille qui l’héberge, puis sa mère. Pour un temps, la nef astrale gardera ses mystères puisque c’est Washington que nous sillonnerons, suivant les pas du touriste Carpenter. À l’instar du nigaud campé par James Stewart dans Monsieur Smith au Sénat (Frank Capra, 1939), il visite quelques-uns des plus grands monuments de la capitale américaine, fasciné par la grandeur passée de l’Homme.
C’est dans ce cadre réaliste et avec une grande parcimonie que le cinéaste fait resurgir les aptitudes exceptionnelles de l’extraterrestre. Sa faculté à déverrouiller les portes ou à résoudre les équations mathématiques les plus poussées, sont autant de prouesses suggérant les capacités sans limites de Carpenter. Robert Wise laissant au spectateur le soin d’imaginer l’étendue du pouvoir de cet être-là alors qu’il pourrait être tenté de nous épater et de trop en montrer. Cette économie visuelle se retrouve dans l’épisode de l’arrêt de la Terre, point culminant du film. Si le monde est divisé et que personne ne semble prêt à écouter ce message venu d’ailleurs, Carpenter décide d’attirer l’attention sur lui en mettant la Terre sur pause. Usines, voitures, locomotives… il stoppe – on ne sait comment – toute activité terrestre. L’idée est simple mais très efficace, et ne requerra l’utilisation d’aucuns effets spéciaux. Ce qui explique sans doute que la scène passe complètement à la trappe dans l’éponyme remake écologique du film que réalisa en 2008 Scott Derrickson.
Les choix de Wise ont le mérite de ne pas détourner notre regard du propos du film et sa morale humaniste s’en trouve renforcée. Cet alien veut notre bien, y compris quand il fait la démonstration de sa toute-puissance. Quant à la violence, elle est l’apanage de l’Homme, chose que Klaatu va apprendre à ses dépends. Alors que son identité est sur le point d’être révélée, et que même ses premiers alliés se questionnent sur la nature de ses desseins, le final du film met en place un suspense : le messager arrivera-t-il à se faire entendre ? Tué par l’armée, puis ressuscité temporairement (énième image messianique), Klaatu peut enfin s’exprimer : « Si vous menacez d’être un danger pour les autres, cette terre qui vous abrite sera réduite en un monceau de cendres. Votre choix est simple, vous joindre à nous et vivre en paix, ou poursuivre votre action néfaste et à jamais disparaître. Votre avenir ne dépend que de vous, nous attendons votre décision ». Ce final est à l’image de l’œuvre : très pessimiste quant à la nature de l’Homme. C’est bien une fois libéré de toute contrainte humaine, revenu d’entre les morts, que Klaatu sera finalement entendu. On retrouvera cette même résignation quelques années plus tard chez Akira Kurosawa, quand le seul personnage lucide face au péril atomique de Vivre dans la peur (1955) sera diagnostiqué fou et interné en asile psychiatrique.