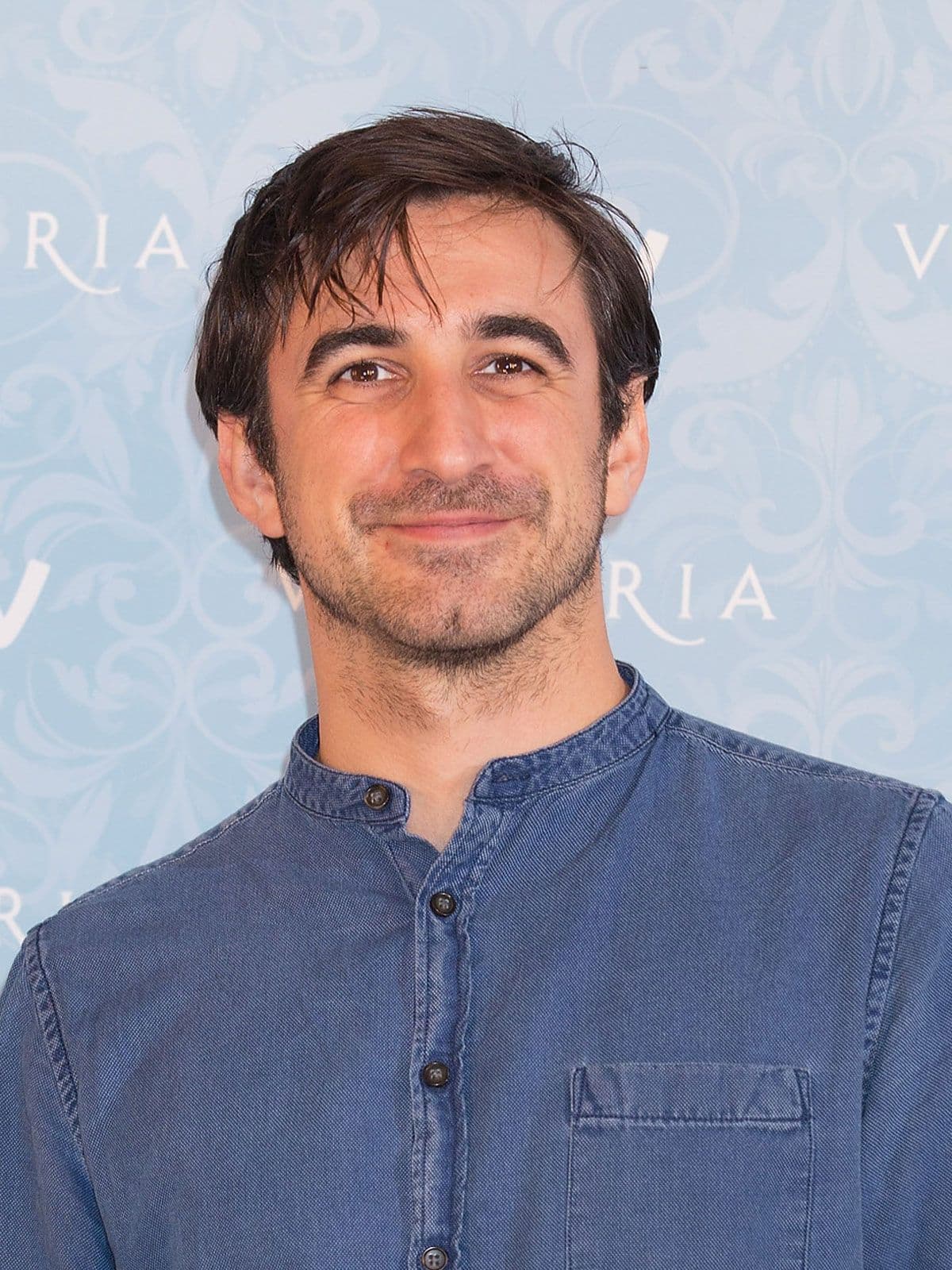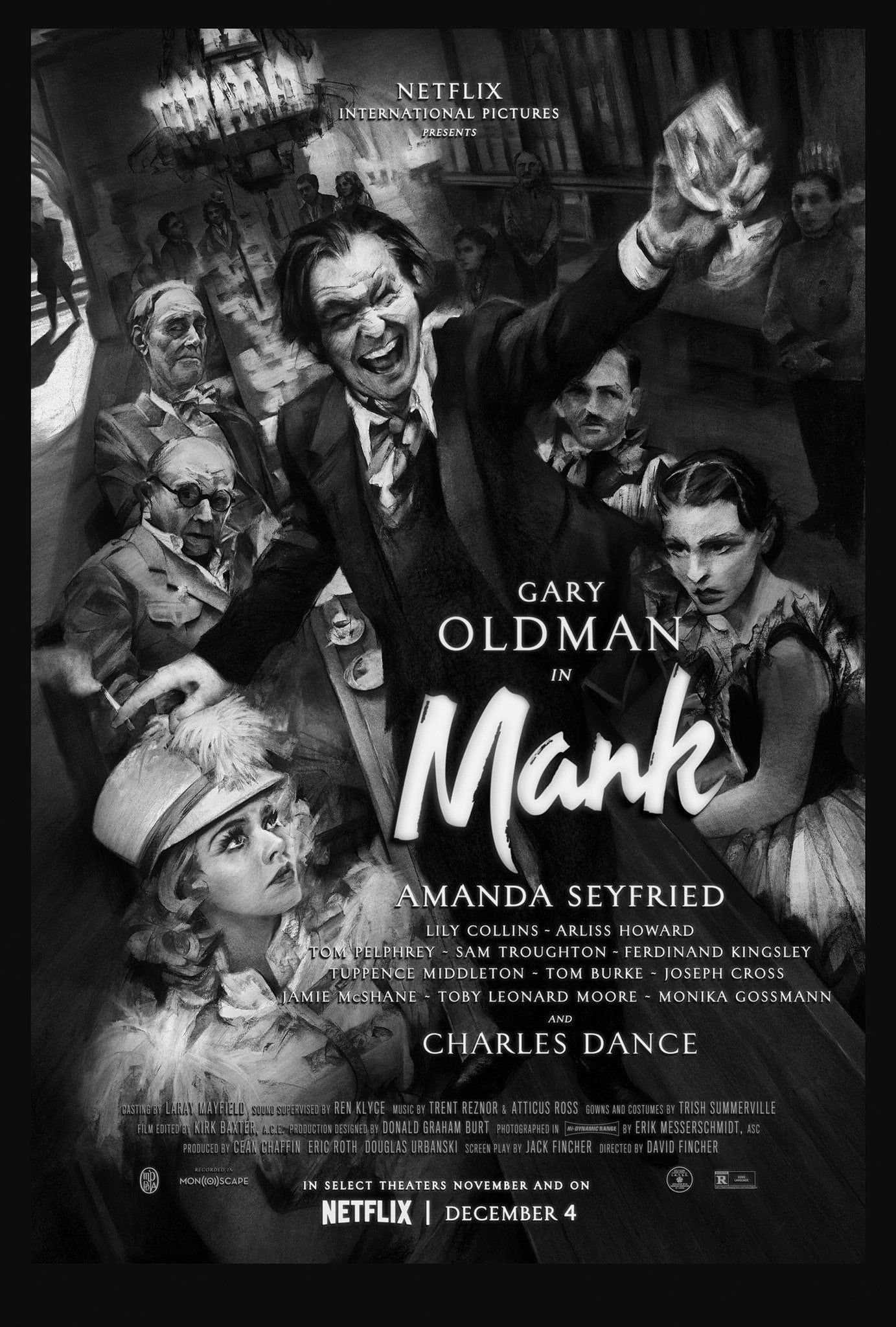
Mank
De David Fincher
2020
Drame / Historique
2h11
Synopsis
Le Hollywood des années 1930 est revisité à travers le regard de Herman J. Mankiewicz, critique social cinglant et scénariste alcoolique, tandis qu'il s'efforce de terminer au plus vite l'écriture de Citizen Kane pour Orson Welles.
Regarder en ligne
Netflix
Abonnement
Bande d'annonce
Avis et Commentaires
11 avis
🎬 Les coulisses d'Hollywood sublimés par la caméra de David Fincher, belle lumière, beaux décors, belle photo, beau noir et blanc. Immense performance de Gary Oldman et Amanda Seyfried. Le film suit Herman Mankiewicz dans ses errements, entre alcoolisme et éclairs de génie, entre vanité et vive intelligence, qui tente de terminer le script de Citizen Kane d'Orson Welles. David Fincher a fait le choix de tourner le film entièrement en noir et blanc à la manière des films d'autrefois. Très bonne surprise inattendue de Netflix pour ce long métrage. 🎬 🎬 🎬

7.5