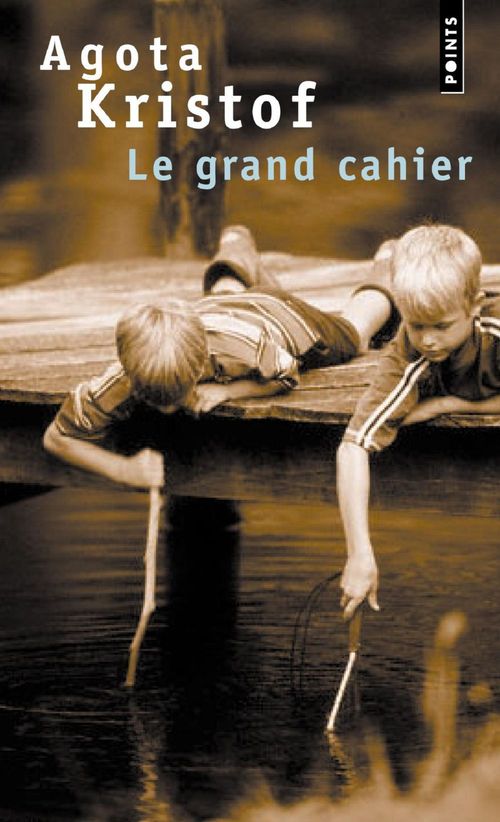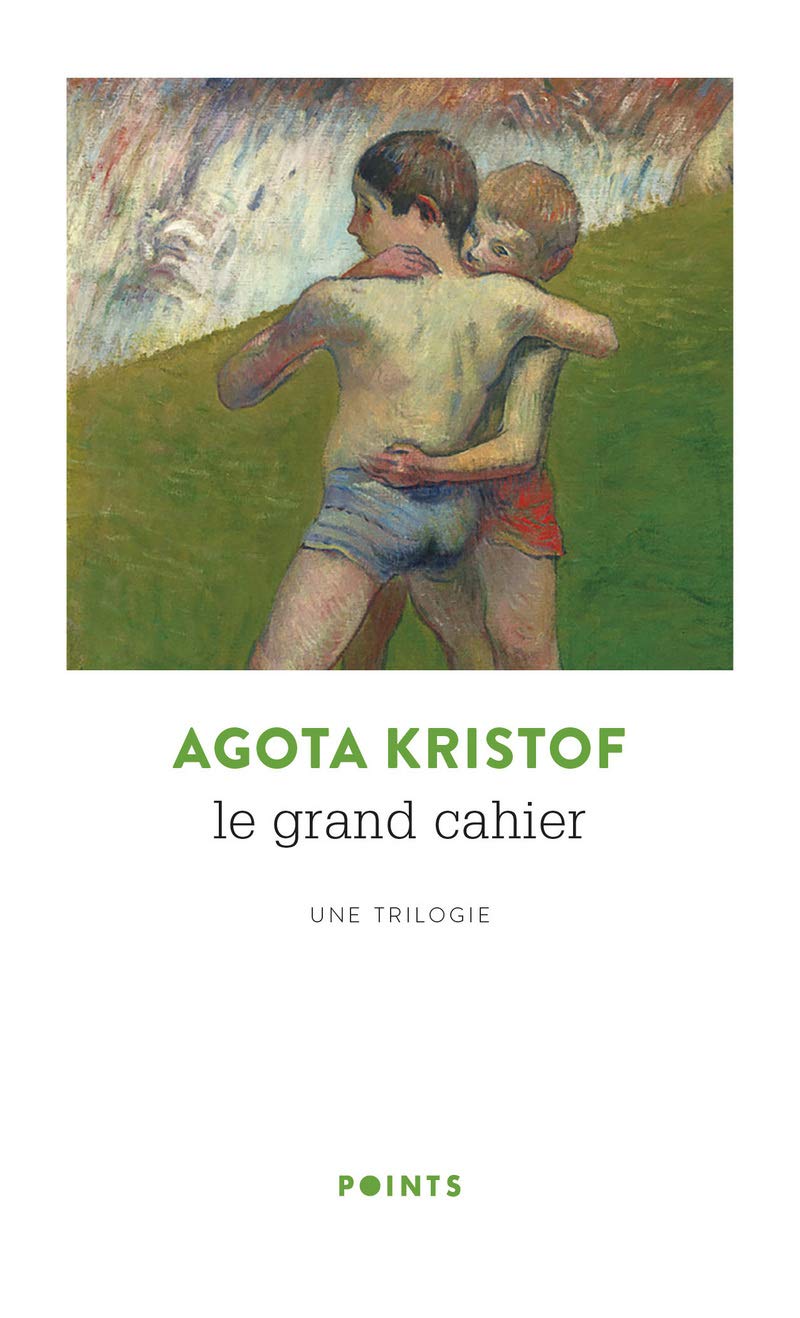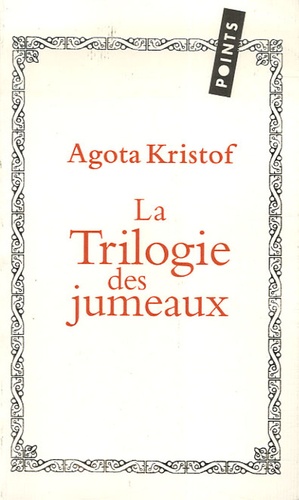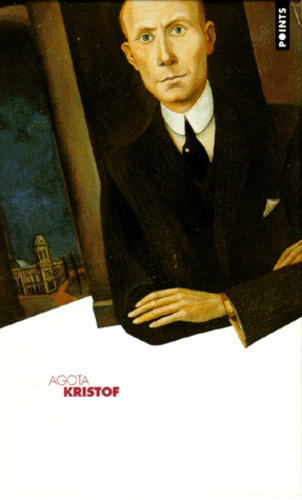Trilogie des jumeaux
2006
•
Agota Kristof
Plus d'infos
Summary
"J'essaie de raconter mon histoire, mais je ne peux pas, je n'en ai pas le courage, elle me fait trop mal. Alors j'embellis tout. "
Avis et Commentaires
3 avis
Recommandé par EvanSupa "Recommandé par Memorizer, car vous avez aimé 'Vernon Subutex'."
Le Grand Cahier commence, l’air de rien, avec des mots très simples. La Grande Ville, Grand-Mère, les enfants, la guerre. Les lieux échappent à une description précise. Ils sont simplement la forêt, la rivière. Les personnages n’ont pas de noms, ils ont avant tout une fonction : la Mère, le Père, le soldat… ou se réduisent à une insulte : Bec-de-lièvre, la Sorcière. Le récit, ainsi raconté par deux garçons jumeaux, tellement indissociables qu’ils disent toujours « nous », acquiert la dimension d’un conte. Mais, comme dans les contes, la cruauté n’est jamais loin. Elle attend toujours au tournant, dissimulée derrière le tranchant des mots et la sobriété des phrases. « Nous l’appellerons Grand-Mère./ Les gens l’appellent la Sorcière./ Elle nous appelle “fils de chienne”. » Dans ces trois phrases, il y a tout l’esprit du Grand Cahier et de la trilogie : le poids du langage, l’univers de la fable et la cruauté. Une cruauté d’autant plus violente et sourde que les deux enfants qui racontent leur histoire préfèrent la froideur de la description sèche à l’épanchement. « Pour décider si c’est “bien” ou “pas bien”, nous avons une règle très simple : la composition doit être vraie. (…) Par exemple, il est interdit d’écrire “Grand-Mère ressemble à une sorcière” ; mais il est permis d’écrire : “Les gens appellent Grand-mère la sorcière.” (…) Nous écrirons “Nous mangeons beaucoup de noix” et non pas “Nous aimons les noix”, car le mot “aimer” n’est pas un mot sûr, il manque de précision et d’objectivité. “Aimer les noix” et “aimer notre mère”, cela ne peut vouloir dire la même chose. » Une manière comme une autre de s’endurcir face à la dureté du monde, de bâtir un rempart contre les humiliations et de tenir les autres à distance. Car Le Grand Cahier ignore le paradis de l’enfance. Quand l’histoire commence, c’est déjà la guerre, déjà la séparation, déjà les coups et la violence. Contre toutes ces douleurs, contre ce monde qui les condamne, les deux jumeaux construisent un univers dur, où il n’y a de place ni pour les sentiments, ni pour la complaisance, ni pour l’apitoiement. Il leur reste l’écriture, la cruauté qui venge et le fait d’être deux, soudés l’un à l’autre, à jamais « nous » pour conjurer les séparations qui blessent : le départ de la Mère, la mort des uns et des autres. Jusqu’à une autre séparation. La leur, cette fois. Jusqu’à ce que l’un franchisse la frontière, accédant à la liberté grâce à la mort d’un autre. L’histoire pourrait s’arrêter là. Mais non, Agota Kristof poursuit avec La Preuve en s’attachant aux pas de celui des deux jumeaux qui est resté. Il a acquis un nom, Lucas. Il est devenu adulte, il vit seul et mal après la séparation d’avec son frère. « Lucas dit : – Moi je vois mon frère partout. Dans ma chambre, dans le jardin, marchant à côté de moi dans la rue. Il me parle. – Que dit-il ? – Il dit qu’il vit dans une solitude mortelle. » Malgré tout, Lucas se remet à vivre, il faut bien. De son enfance, il a gardé un mélange de bonté et de cruauté. Il protège souvent les êtres blessés dont il croise la route, sans doute parce qu’ils lui rappellent sa propre tragédie, mais il agit parfois avec eux avec brutalité. Il recueille Yasmine, la femme répudiée, mais la sacrifie pour garder Mathias, son fils infirme. Chez lui, le Bien et le Mal sont des valeurs qui n’ont pas cours. D’autant que, dans La Preuve, l’amour peut tuer aussi sûrement que l’abandon. A commencer par Mathias, le petit garçon blessé, orgueilleux, que l’amour de Lucas ne parviendra pas à sauver – pire : qu’il aura tué. Et puis voilà que tout bascule, voilà que surgit un immense doute : et si ce frère n’avait jamais existé, si Lucas avait tout inventé ? C’est ce que pense depuis toujours l’ami et le secrétaire du parti, Peter. Il finit par insinuer le doute dans notre esprit, d’autant plus que Victor, le libraire, ne se souvient pas d’un autre enfant. Le doute grandit encore lorsque, plusieurs années après la disparition de Lucas, un homme réapparaît, se faisant appeler Claus, et dit chercher son frère. Et soudain, en quelques pages finales, il n’y a plus aucun doute : Lucas et Claus ne forment qu’un. Le « nous » du Grand Cahier n’a jamais existé. Encore une fois, l’histoire pourrait s’arrêter là. On pense tout savoir. Un enfant, pour éviter de souffrir, s’est inventé un compagnon imaginaire. Il a écrit Le Grand Cahier, et nous y avons cru avec lui. C’est méconnaître l’art de la chausse-trappe d’Agota Kristof et son exploration vertigineuse du « mentir vrai » en littérature, « des histoires qui ne sont pas vraies mais qui pourraient l’être ». Derrière l’apparente simplicité du style se dissimule en effet une complexité dans la construction, un art de la porte dérobée qui conduit, ultime paradoxe, au dévoilement de la vérité sous le titre ambigu du Troisième Mensonge. Mais cette vérité reprend bien des éléments des deux premiers livres. L’histoire qu’on nous raconte n’est pas tout à fait la même, et pourtant on y retrouve le drame initial, la violence et la mort, l’abandon et l’infirmité, la grand-mère qui appelle l’enfant « fils de chienne », la ville où « le ciel prend des couleurs orange, jaune-violet, rouge et d’autres couleurs pour lesquelles il n’existe pas de mots », même Peter et Clara, les bistrots et la librairie, le jeu d’échecs et l’harmonica. On referme alors Le Troisième Mensonge un peu sonné, en se disant que les plus belles histoires, ou du moins celles qui sauvent, sont celles que l’on s’invente pour conjurer le sort et la peur. « Je lui réponds que j’essaie d’écrire des histoires vraies, mais à un moment donné l’histoire devient insupportable par sa vérité même alors je suis obligé de la changer. Je lui dis que j’essaie de raconter mon histoire mais que je ne le peux pas, je n’en ai pas le courage, elle me fait trop mal. Alors j’embellis tout et je décris les choses non pas comme elles se sont passées mais comme j’aurais voulu qu’elles se soient passées », raconte Lucas à sa logeuse. La littérature reste le meilleur remède pour conjurer l’humiliation et la douleur, même si toujours les mots manqueront. « Je n’en ai pas encore trouvé pour qualifier ce qui nous est arrivé. Je pourrais dire drame, tragédie, catastrophe, mais dans ma tête j’appelle cela simplement “la chose” pour laquelle il n’y a pas de mot. » Agota Kristof, elle, a trouvé les siens