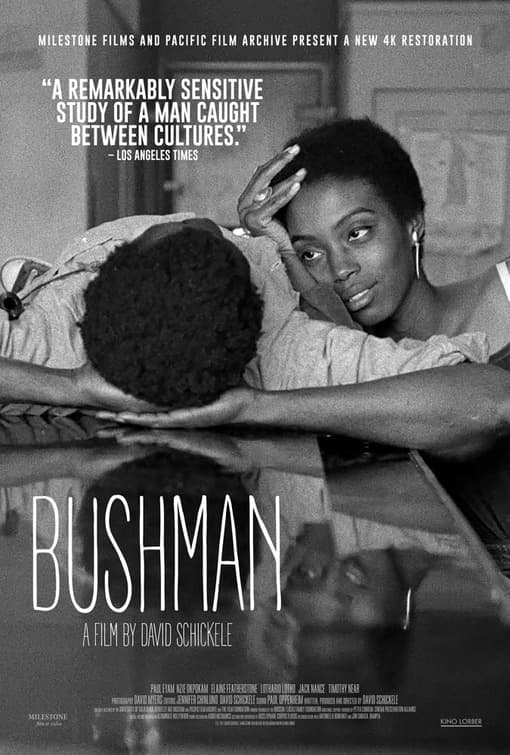
Bushman
By David Schickele
1971
Documentary / Drama
1h13
Synopsis
1968: Martin Luther King, Robert Kennedy, and Bobby Hutton are among the recent dead. In Nigeria, the Civil War is entering its second year with no end in sight. In San Francisco, the adventures of Gabriel, a young Nigerian reflects tribal, personal, and racial frictions during the tumultuous sixties. Truth is stranger than fiction in Bushman, a rare sort of film portrait, part document, part imagined – poetic in its approach to real events.
Watch online
Criterionchannel
Subscription
