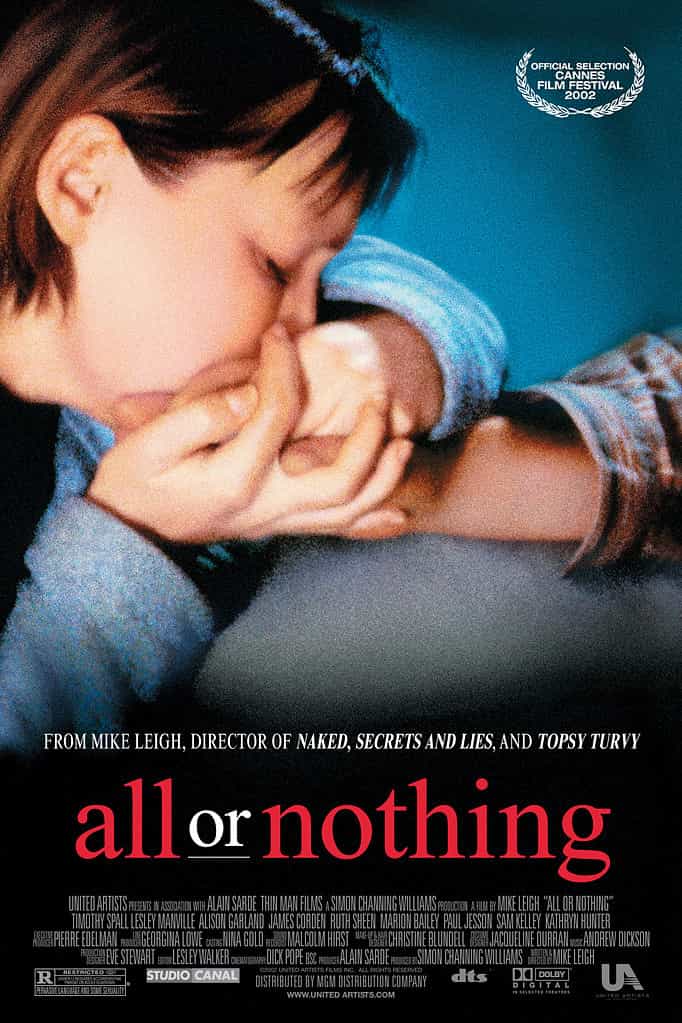Mr. Turner
By Mike Leigh
2014
History / Drama
2h30
Synopsis
Eccentric British painter J.M.W. Turner lives his last 25 years with gusto and secretly becomes involved with a seaside landlady, while his faithful housekeeper bears an unrequited love for him.