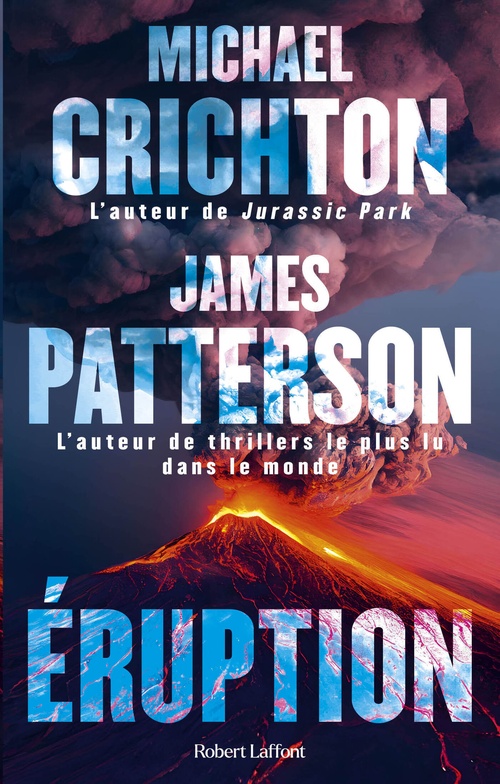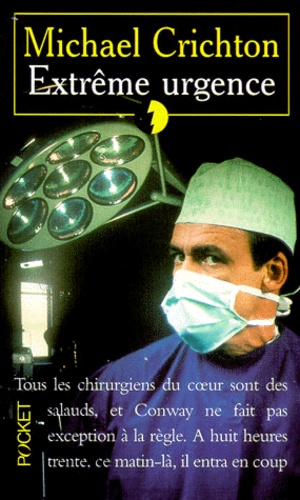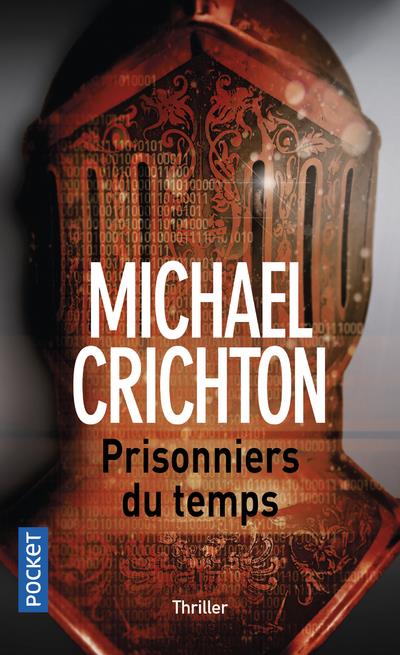On le sait tous : ressusciter des dinosaures est une idée profondément stupide.
Mais en même temps… ce serait quand même sacrément cool à voir.
Michael Crichton construit son roman presque comme un scénario. Le chapitrage, très court, découpe nettement les scènes et les lieux d’action. Il prend le temps de faire monter l’idée même de l’existence des dinosaures, en disséminant progressivement des indices qui rendent cette aberration scientifique presque acceptable — du moins en 1990. Ce choix installe un suspense en amont des événements que nous connaissons tous et nous amène logiquement à la rencontre du docteur Alan Grant et de sa (jolie) stagiaire. Par la suite, ces micro-chapitres alternent les points de vue, les lieux et les intrigues parallèles, tout en indiquant clairement la progression temporelle.
Le roman est extrêmement détaillé sur le plan scientifique, sans pour autant perdre le lecteur. Crichton maîtrise son sujet et sait vulgariser sans alourdir.
Dès le préambule, il installe une fiction retraçant l’histoire de la génétique, donnant de la consistance aux recherches d’InGen, mais aussi à la concurrence entre méga-entreprises. Cette pression financière nourrit la corruption de l’élément perturbateur principal du parc et donne une véritable épaisseur économique au récit.
Dans le film, Jeff Goldblum incarne Ian Malcolm, un contrepoint essentiel aux dinosaures : sarcasme, réflexions acides, humour salvateur pour désamorcer la terreur. Dans le roman, on n’en est pas loin, mais l’humour se fait plus subtil et, surtout, les théories de Malcolm sont beaucoup plus développées et pertinentes. Il est moins punchline, plus penseur.
La différence majeure entre le livre et son adaptation se cristallise dans le personnage de John Hammond. Aussi attachante soit l’interprétation de Richard Attenborough, la version romanesque est bien plus cohérente : Hammond y est moins sympathique, plus cynique, plus crédible. La célèbre phrase « J’ai dépensé sans compter » est absente du roman. Ici, le budget doit être justifié auprès de créanciers présents bien avant l’arrivée des personnages. Dès lors, la trahison de Nedry devient logique, presque inévitable.
Lire le roman après avoir vu le film ajoute d’ailleurs un plaisir supplémentaire. L’imaginaire se nourrit des images de Spielberg pour les prolonger dans des situations trop folles ou trop complexes pour passer à l’écran — comme la fuite face au T-Rex dans la rivière.
Lorsque tout dégénère, la précision et la lisibilité des scènes d’attaque sont impressionnantes. Crichton maîtrise chacun de ses dinosaures (selon les connaissances de l’époque) et exploite méthodiquement leurs caractéristiques. Le découpage des attaques, l’agencement des intrigues parallèles et la progression de la catastrophe sont d’une clarté remarquable et tiennent le lecteur en haleine.
Difficile, alors, de ne pas penser à ce qu’est devenue la franchise. Tout ce que Spielberg n’a pas utilisé sera recyclé plus tard : timidement dans Jurassic Park III (la plage, la volière), puis exploité jusqu’à l’os dans les Jurassic World. De nombreux thèmes secondaires y étaient déjà présents dans le roman original — notamment l’idée d’un jeune vélociraptor développant une forme d’attachement envers les humains….Vous me suivez ?