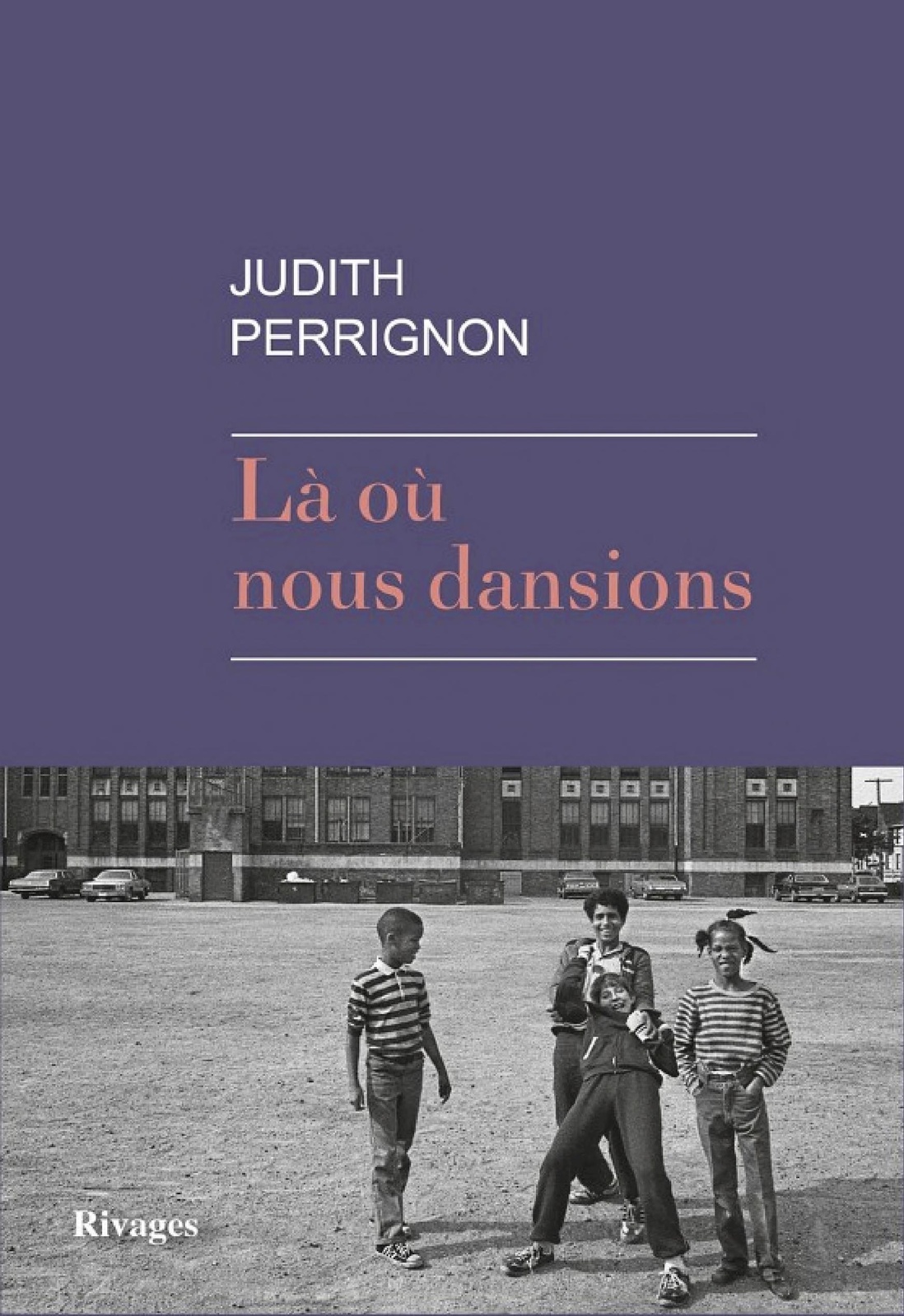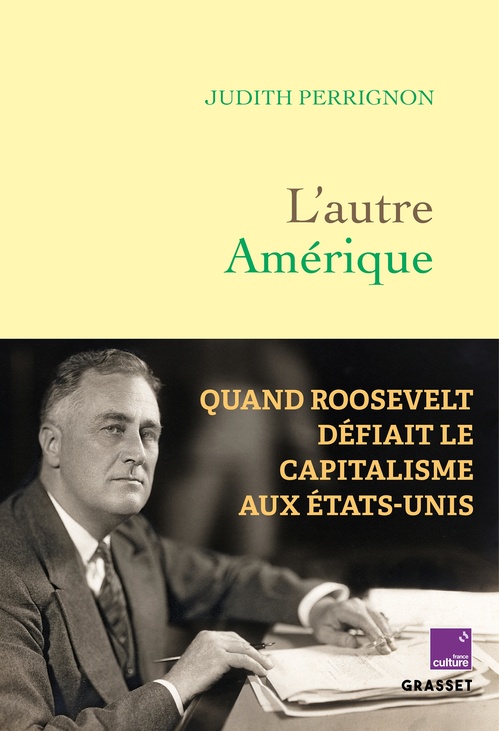Marceline Loridan-Ivens (1928-2018) a été déportée à l’âge de quinze ans pendant la Seconde Guerre mondiale. Les camps de la mort, Auschwitz, Birkenau, aux côtés de Simone Veil. Elle en reviendra sans son père.
« Mon corps de femme s’est dessiné en même temps qu’il était condamné. A Auschwitz. Que faire de lui ensuite puisque j’avais survécu ? Serait-il capable de désir, de plaisir… D’aimer tout simplement ? », s’interroge l’auteure qui, un jour, ouvre une vieille valise. Elle en sort des listes de livres, des billets de spectacles, des mots griffonnés. Des lettres aussi. Ecrites par des compagnes de désespoir, par des hommes qui l’ont aimée. Par d’autres qu’elle a simplement croisés. Il y a Francis Loridan, son premier mari, l’écrivain Georges Perec, le sociologue Edgar Morin, Jean tellement plus jeune qu’elle, le documentariste Joris Ivens, son deuxième mari de trente ans son aîné… et aussi Freddie rescapé comme elle, Camille beau comme Brando…
À vingt ans, à Saint-Germain-des-Prés, dans les premières années 1950, elle vit l’aujourd’hui. Pour (tenter de) gommer l’horreur du passé. Pour « continuer », comme le lui suggérera un jour une psychanalyste ? Mais le corps, lui, a-t-il oublié ? Peut-il seulement oublier ?
En ouverture de « L’Amour après », l’auteure rappelle les mots du fondateur de la psychologie analytique, C.G. Jung : « La vie non vécue est une maladie dont on peut mourir ».
Au fil des pages, les souvenirs du temps passé et les événements du temps présent s’enchaînent. On devine qu’elle a connu, au moins une fois, peut-être même une seule fois, le véritable amour, le grand amour. Ce fut avec Joris Ivens.
Un grand et beau texte, dense et furieusement libre, sur le corps, sur l’amour, sur l’apprentissage de la « chose amoureuse », sur la réappropriation du corps après un passage dans les camps de la mort.