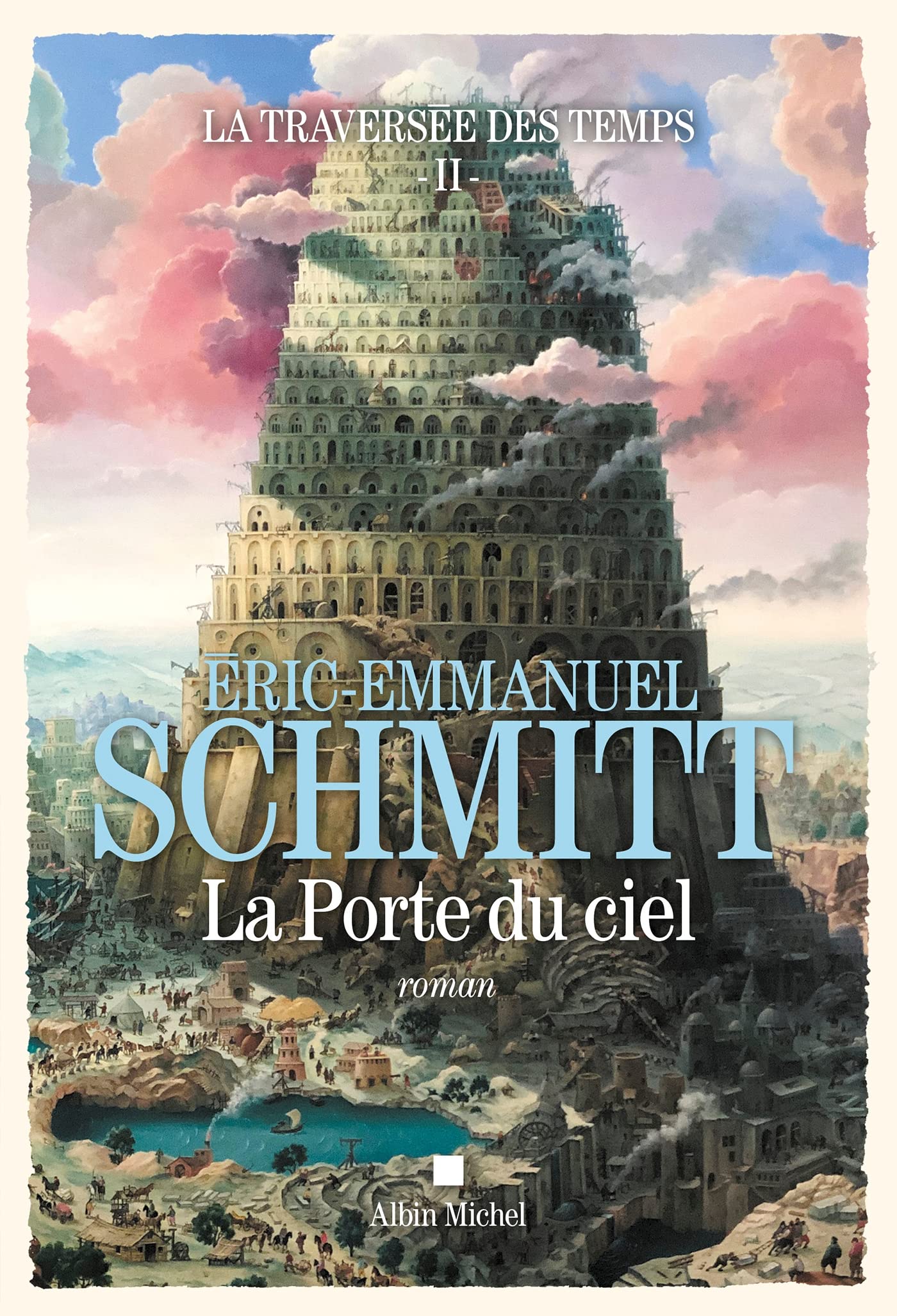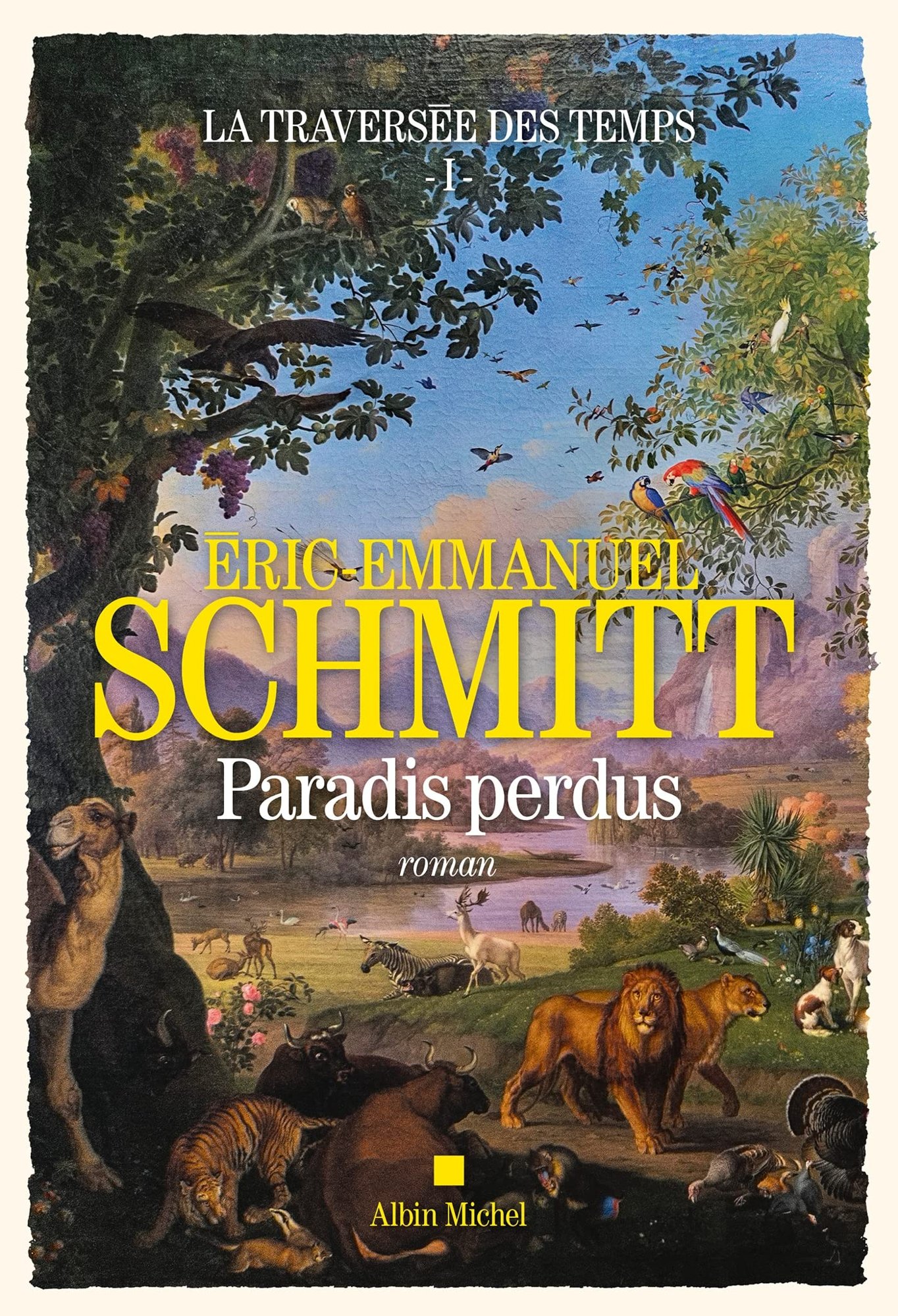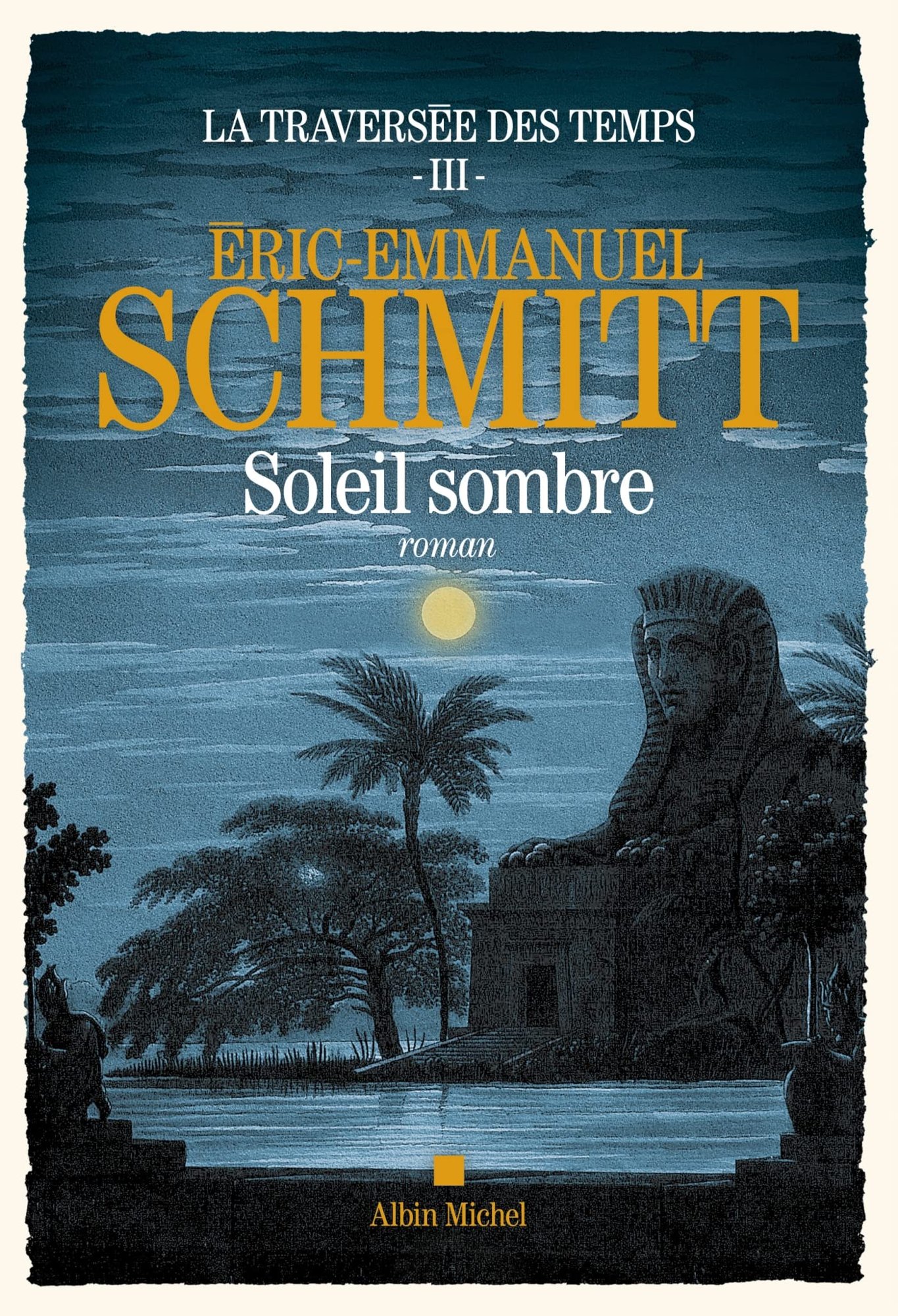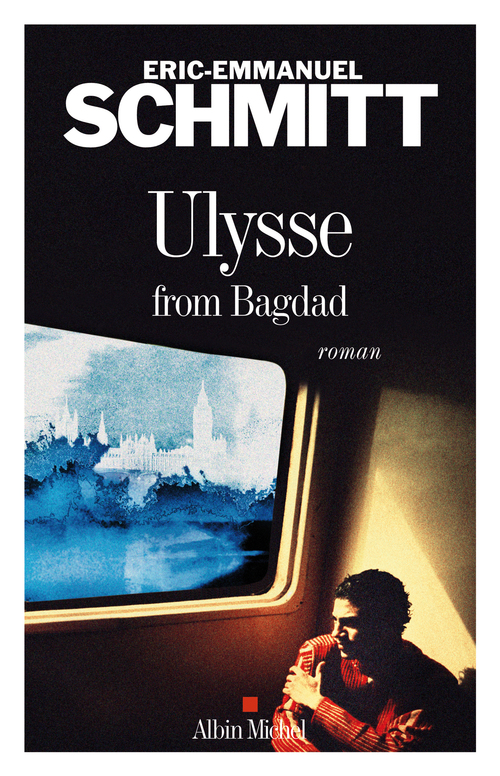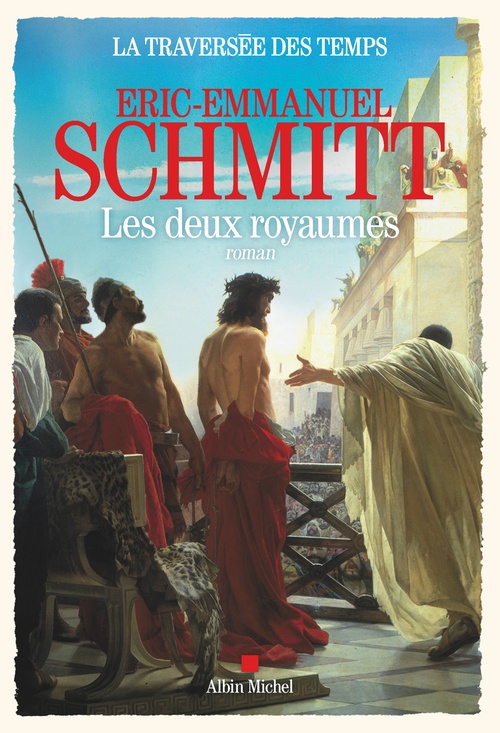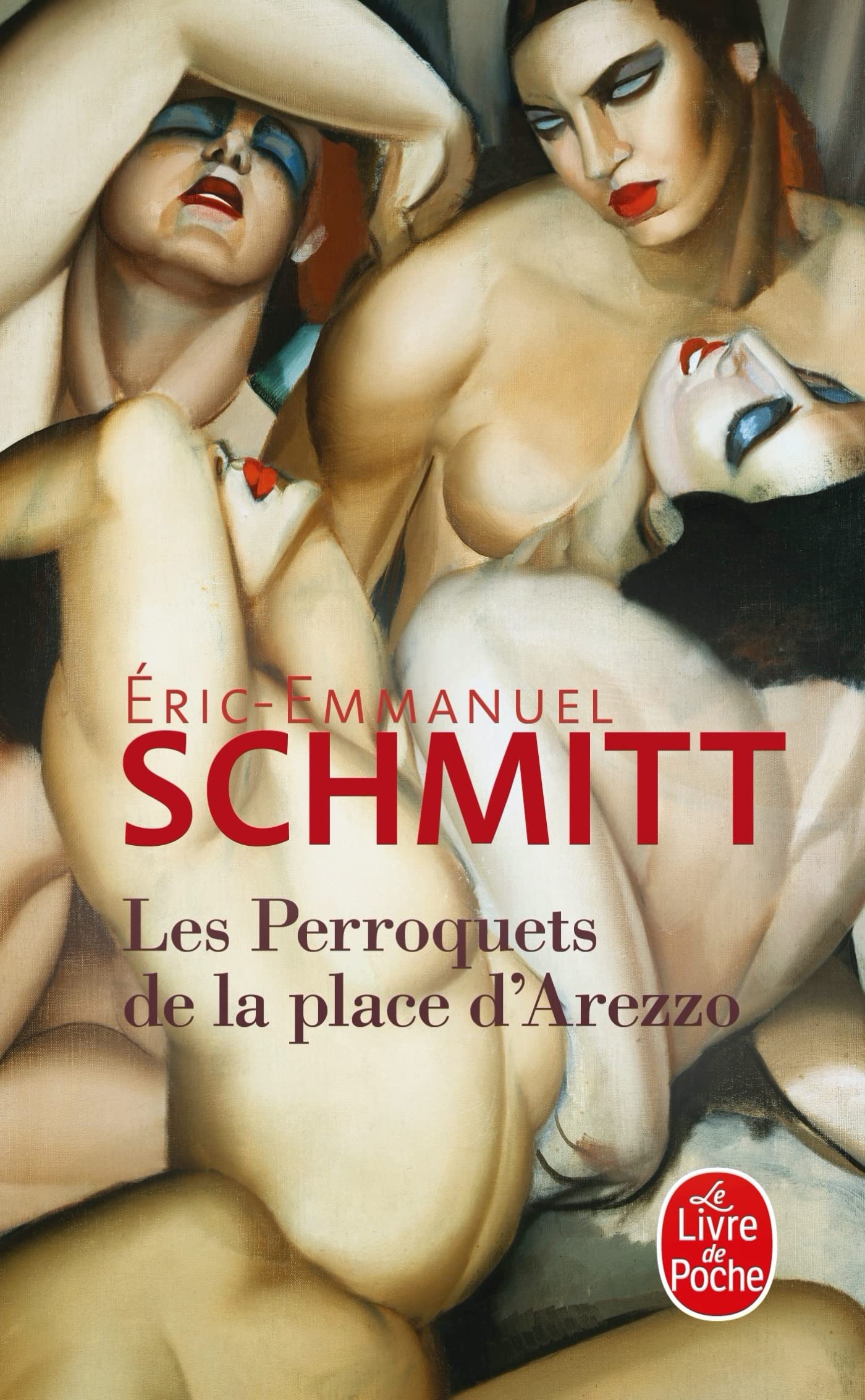Éric-Emmanuel Schmitt – la Traversée des temps tome II
La Porte du Ciel Livre de Poche 36988 – 623 pages
Des mollusques munis d’extrémité en surchauffe (en parlant des adolescents) – p 13
La saponaire, une plante courante près des ruisseaux. On l’appela « l’herbe à savon », ou la savonnière une fois que le savon fut inventé. Ses rhizomes longs et rougeâtres ainsi que ses fleurettes roses ont la propriété de mousser, de laver, de désinfecter. Séchées et réduites en poudre, elles permettent même de se nettoyer les mains sans eau – p 58.
En ce temps-là, un peigne ne se prêtait pas, il accompagnait une personne, témoin de son statut social, de son identité et relié à son totem. Egarer son peigne, autant que perdre ses cheveux relevait d’une malédiction des Dieux – p 60.
Je pratiquais la rêverie que m’avait enseignée Tibor, cette décontraction du cerveau qui, cessant de désirer, de consommer, de faire, abandonner tout rapport utilitaire avec l’univers, et se laisse pénétrer par ses forces -p 68.
Folichonner : Se divertir d'une manière très libre ou très enjouée- p 69.
Chasse-démons : on appelait ainsi le millepertuis pour ses qualités d’exorciste : le chasse-démons débusquait les mauvais esprits qui empêchait un homme de vivre soit la nuit – insomnie -, soit le jour – mélancolie. Le millepertuis répare les plaies en cas de piqûre, d’infection ou de brûlure ; il a des propriétés cicatrisantes, anti-inflammatoires et antiseptiques –p 70.
La tourmaline noire, pacificatrice… tandis que le quartz rose entretient l’ardeur (sexuelle) – p 73.
Le nom actuel des « yeux de biche » est la « belladone », lequel signifie à peu près la même chose. A la Renaissance, les italiennes élégantes utilisaient son jus pour attirer. Comme l’atropine qu’elle contient dilate la pupille et donne un œil noir, profond – un œil de biche, celui que nous avons tous au moment de l’orgasme -, elles s’instillaient quelques gouttes d’une infusion sous les paupières ou en appliquaient une compresse, devenant ainsi d’irrésistibles « belles dames », belle donne en italien. D’ailleurs, la belladone ne les rendait pas seulement belles, mais folâtres par ses effets psychotropes. Hélas, prise en plus grande quantité, elle les rendait folles, voire les tuait. En tout temps, les coquettes ont flirté avec la mort – p 74.
Des sanglots m’ébranlèrent, puissants, ravageurs, des sanglots venus de loin, de mes entrailles, de mon enfance, les spasmes d’un garçonnet, découvrant son insuffisance, cesse de se rêver en héros. La claque de la lucidité – p 78.
Un sentier, c’est la mémoire que la terre garde des hommes. Plutôt que fait pour marcher, il est fait par les marcheurs. A l’échelle de l’univers, les voyageurs et leurs ânes ne pèsent guère, ils passent ; pourtant leurs effleurements plient l’herbe, leurs foulées polissent l’argile, leurs pieds rapides modèlent un sillon. L’infime finit par creuser sa marque… Le macadam lui n’a pas de mémoire. Ingrat, indifférent, il oublie, il nie… - p 91.
Le sentier diffère de la route. Alors que le sentier reste un chemin obtenu par le consentement du paysage, puisqu’il suit ses mouvements, la route conçue abstraitement par des géomètres, l’agresse en la coupant. Le sentier épouse la nature, la route la viole – p 92.
La nostalgie mord autant qu’elle caresse – p 119.
Je savais ce qui allait se passer. Même si je ne l’acceptais pas, je le savais. Quelque chose d’intense dans sa présence me privait de volonté – p 123.
En définitive, nous subissions notre destin, le destin qui m’avait créé homme, le destin qui l’avait créée femme. N’exagérais-je pas en prétendant m’opposer ? A lutter contre l’évidence naturelle, ne tombais-je pas dans un excès d’orgueil ? – p 125.
Les images sont des dessins muets. Les signes sont des dessins sonores – p 162.
Sanctuaires hypèthres (hypo : sous ; aethre : air : dépourvus de toiture ou seulement en partie – p 166.
L'architecte d'aujourd'hui peinerait à s'entendre avec l’architecte mésopotamien, égyptien, grec de l'Antiquité. En quelques siècles, ils sont presque devenus étrangers l'un à l’autre tant leurs philosophies divergent. Pour le moderne, l'architecture répond à une fonction, pour l'ancien, elle transmet une signification. Quoique les deux élaborent des techniques, ils n'ont pas de visées identiques : le moderne regarde l'utile, l’ancien le symbolique. Aux yeux de Gungunum, une colonne ne se limitait pas à un soutien ou à une force porteuse, elle figurait l’axe du monde, un chemin vers le ciel, ce qui permettait aux humains de se situer puis de s'élever. Pareillement, une arche, une coupole, un dôme ne se réduisaient pas à un toit décoratif astucieusement conçu mais reproduisaient la voute céleste, ce domaine des Dieux. Même une porte ne se contentait pas d’ouvrir sur un espace, elle indiquait une direction, celle du soleil couchant ou de l’aurore… Ils ne distinguaient pas le pourquoi du comment, la métaphysique de la physique – p 203.
En 1831, devant l'Académie royale de médecine à Paris, la scène que j'avais vécue avec la reine Kubaba se reproduisit. A plusieurs millénaires de distance, les vertus du charbon végétal furent prouvées de façon spectaculaire. Le pharmacien Pierre-Fleurus Touéry, venu de Montpellier, avala une dose mortelle de strychnine - un gramme, soit dix fois la quantité létale - face à I ’assemblée scientifique. Il aurait dû succomber en dix minutes d’un arrêt respiratoire après des convulsions ; or il se maintint debout au milieu du public pantois. Touéry voulait démontrer que la poudre de charbon constituait un antidote universel. Précisons néanmoins : universel, cet antidote ne l'est pas, mais la capacité d'absorption du charbon lui permet de fixer les toxines et les microbes qu'il rencontre, même les gaz, d'ailleurs, puisqu'il agit efficacement contre les ballonnements intestinaux et qu'il équipa les masques à gaz utilisés pendant la guerre de 1914 – p 283.
Partout, les temples d'Inanna répandaient ce message : la volupté constitue un devoir religieux ; tout dévot, toute dévote a pour mission de jouir et de faire jouir ; l'accomplissement sensuel représente un accomplissement spirituel ; il faut s'élever en baisant beaucoup et bien ; l'érotisme propose une conquête qui arrache l'homme à la terre pour le conduire au ciel (tantrisme ?). La campagne, jour et nuit, retentissait de cris, de soupirs, de râles, de halètements lubriques. La joie éclatait au rendez-vous. On le sait, plus le plaisir s'intensifie, plus il devient sonore ; les amants rivalisaient donc de braillements, de mugissements, de rugissements, ceux qui encouragent la montée de l'orgasme, ceux qui encouragent la montée de l'orgasme, ceux qui l'appuient, ceux qui le commentent, ceux le hâtent, ceux qui le retiennent, ceux qui le maintiennent, ceux qui le chantent, ceux qui le regrettent... Non seulement ni pudeur ni interdit ne muselaient les partenaires, mais ils finissaient par quêter l'extase au bout du bruit – p 313.
D’un soir estival, même quand la chaleur se repose – p 314.
Par quelle aberration une réalité si intense, si solide pouvait-elle s’émietter, se réduire en poussière au fond d’une conscience ? Ce constat m’oppressait – p 314.
L’argile offre le meilleur moyen de stockages de données. Si sa capacité est limitée, sa durée de vie est illimitée – p 324.
Choléra ou mal bleu, qui signifie « gouttière, évacuation incessante » - p 326.
En eux, l’obéissance meublait le vide laissé par l’intelligence – p 330.
Je préfère ne pas – p 396.
Le prestige de l’or résulte de son incorruptibilité, non de sa rareté. Puisque que ce métal miraculeux ne ternissait ni ne s’oxydait, sa splendeur à l’évidence ne pouvait avoir à l’origine qu’une émanation divine- p 400.
L’or serait le fruit d’une collision violente entre deux étoiles à neutrons, un cataclysme cosmique qui se serait passé il y a qq milliards d’années. Issu des étoiles, l’or se serait répandu sur Terre sous la forme de gisements grâce à l’activité géothermique – p 400.
Selon Abram, on ne vivait pas pour exulter, mais pour s’élever – p 402.
La pitié reste une des couleurs de l’amour – p 438.
Le Dieu d’Abraham n’était pas le Dieu unique. Pas encore… Abraham se montrait davantage hénothéiste que monothéiste : il avait un culte préférentiel. Son Dieu détenait une suprématie incontestable à ses yeux, mais il n’excluait pas les autres. D’ailleurs, il portait un nom qui relevait d’une pensée polythéiste. Yahû, Yahô, Yahva, son Yawhé était « celui qui souffle », qui amène le vent, une divinité des steppes et des sols arides. L’idée d’un seul Dieu ne touchait, ni n’obsédait Abraham – p 475.
Plus que jamais, on voyage dans une idée du monde, pas dans le monde réel. L’humain contrôle tout, organise tout, délimite tout. Noam se sent otage de la civilisation, plutôt que son bénéficiaire – p 486.
Dans le feu de ses prunelles (Abraham), je distinguais diverses nuances, l’ardeur de l’amant, la fierté du mari, la hâte du père, la compassion du mâle, le soulagement du chef, la gratitude du croyant – p 491.
Des hanches d’amphore (en parlant d’une femme) – p 493.
Tantôt je me délectais de l’élégance des habitants, raffolais des échoppes prodigues en marchandises, appréciais les méandres architecturaux, les placettes, les terrasses grâce auxquelles on savourait l’existence en regardant vaquer ses contemporains ; tantôt je me sentais captif d’un monde artificiel, détaché de la nature, des saisons, qui anéantissent mes références et m’infligeait les siennes – p 501.
Décèle les défauts de tes adversaires, cache tes qualités – p 513.
Au lieu d’escompter toujours plus de la vie, ils acceptaient ce qu’elle donnait – mieux, ils s’en délectaient. Si les Babéliens, tenant à posséder davantage, se sentaient perpétuellement frustrés, les nomades se contentaient d’être, d’avoir ce qu’ils avaient – p 524.
L’époque contemporaine néglige le poids des noms. Durant des millénaires, nommer et donner vie se confondaient. On respectait le pouvoir créateur des mots. Ce que l’on nommait advenait. Quelle vérité ! On n’offre pas la même existence à l’enfant selon que son prénom signifie « le gai », « le sage », « le vieux », « le triste », « l’heureux » … Depuis le début du christianisme, un individu entrant dans une communauté religieuse efface son identité antérieure et en prend une nouvelle. Comment en vînmes-nous à oublier la puissance fondatrice des noms ? le siècle du progrès s’en chargea. Au XVIIIe, les philosophes, pressés d’évacuer les obscurantismes, les préjugés, les superstitions, ne se fièrent plus qu’à la raison. L’intellect supprima l’irrationnel… L’autrichien Freud ou le français Lacan montrèrent que patronymes et prénoms agissent sur les comportements – p 543.
Puisque la vie nécessitait le sang et la souffrance au nom de quoi les mâles s'en abstiendraient. D'autant que, Abraham l'avait appris, un sexe circoncis se révélait plus propre et plus vaillant, plus propre car les mauvaises odeurs cessaient de se dissimuler au creux de l'humide calotte, plus vaillant car le gland, devenu un peu moins sensible, mettait plus de temps à rejoindre la même intensité de plaisir, ce qui, du coup, en donnait davantage à la partenaire – p 544.
Il y a l’homme et il y a l’humain, l’homme est fait, l’humain reste à faire – p 546.
Hépatoscopie : L'hépatoscopie de hépato-, du grec η̃παρ, η̃πατος (ê par, ê patos) « foie » et -scopie, du grec a -σκοπια (-skop), issu de σκοπει̃ν (skopein) « observer », ou hépatomancie (voir aussi : extispicine ou extaspicine, renvoie à l'analyse du cœur et/ou des poumons, du foie et de la rate d'animaux consacrés lors d'un sacrifice, entrailles, viscères ou splanchnomancie enfin haruspicine) est un art divinatoire pratiqué par les haruspices à partir de l'étude de foies d'animaux sacrifiés, assez répandu, notamment dans les civilisations de la Mésopotamie antique, chez les Phéniciens, les Grecs, puis les Étrusques avant que la Rome antique l'adopte. Cet examen hiéroscopique se rattache à une longue tradition de représentations polysplanchniques populaires dans l'Antiquité – p 565.
Trois façons de concevoir la condition humaine : l’âge archaïque, qui voit en l’homme une création de la nature, l’âge religieux, qui voit en l’homme une création de Dieu, l’âge anthropocentrique, qui voit en l’homme une création de l’homme… J’ai du mal à croire naïvement au progrès – p 593.
Trémuler : être agité de tremblement (du latin tremulus agiter, trembler) – p 600.
La Bible est un livre qu'écrivit un petit peuple de pasteurs effrayé par le développement de l'urbanisation, terrorisé par les premières villes du Moyen-Orient. Tandis que les Mésopotamiens inauguraient une nouvelle conception de la société en se fixant, se resserrant, se massant, les Hébreux, eux, perpétuaient un mode de vie opposé : nomadisme, non-possession des terrains, limitation de l'activité à des tâches élémentaires. Dans la Bible, chaque fois qu'une ville surgit, sa mention s'accompagne d'un jugement péjoratif, voire de connotations diaboliques : Sodome, Gomorrhe, Ninive, Babylone, Jérusalem. Cependant, des rédacteurs plus tardifs prirent la défense de l'une d'elles, Sion, Nouvelle Jérusalem, qui incarnait le triomphe final de l'ordre divin, thème que développa ensuite le chrétien saint Augustin a l'appellation « Jérusalem Céleste » ; or il s'agit d'une cité à venir, d'une cité idéale, d'une cité eschatologique. Aux yeux des bergers, la ville signifiait séparation : rupture avec l'espace environnant par des murailles ; rupture avec le temps des saisons dans un dédale minéral ; rupture avec la nature par l’érection d'un monde artificiel ; rupture avec le reste de l’humanité par l'élaboration d'une identité à l'intérieur d'une enceinte. Pour eux, quoique la ville concentrât les individus, elle dispersait les esprits. A Babel, un groupe s'inventa un nombril et le regarda. Les bergers, s'ils reconnaissaient en Babel une création humaine, y repéraient également une dé-création par rapport à Dieu. Cette prise de pouvoir sur le monde par les hommes ne s’approche pas du divin, elle le défie, voire le remplace. Rédigée à l'extrême fin de la civilisation mésopotamienne, la Bible n’élaborait pas une idéologie nouvelle ; elle rêvait au temps des ancêtres, préférant les anciens aux modernes. Certes, les bergers n’étaient plus des chasseurs-cueilleurs et ne croyaient plus aux Âmes, Nymphes, Divinités, cependant ils conservaient le goût d'une vie simple en harmonie avec le cosmos. Qu’elle ne fut pas ma surprise de constater le voyage qu’avait effectué cette phrase en l'entendant dans la bouche de Jésus (Luc 9, 57.) : les renards ont des tanières, les oiseaux du Ciel des nids, les hommes n’ont pas de lieu où reposer leur tête – p 607.
Chaque royaume assis sur ses richesses finissait immanquablement soit par conquérir, soit par subir la jalousie d’un autre. La guerre résultait de la propriété. Voilà pourquoi il ne fallait jamais posséder la terre – p 608.
Une autre naïveté dans ces représentations frappe Noam : elles racontent Babel comme une fin. Pourtant Babel constituait un début. La Tour s’est effondrée. Pas le désir de la Tour. Avec celui-ci point l’hubris, l’outrance, la boursouflure. L’homme franchit une limite en se dressant au-dessus de la nature, en ignorant sa place dans l’univers, en s’estimant supérieur à tout ce qui n’est pas lui – p 615.